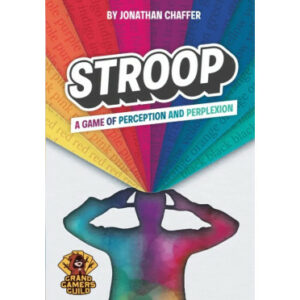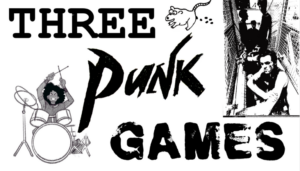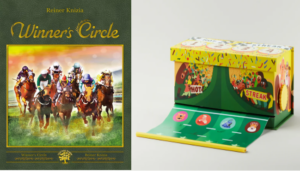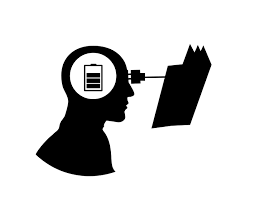
Ce texte est la transcription de la chronique proposée en podcast dans le format Pelleter des nuages (audio dispo ici).
Quand j’ai relu en détail la chronique que tu proposais pour cette émission (Rejouer avec le même groupe, texte disponible ici), après avoir choisi la mienne, j’ai trouvé amusant qu’elles se répondent sur certains points. En effet, tu as évoqué dans ton premier point le fait que rejouer avec le même groupe diminuait la charge mentale. Et c’est bien la charge mentale que je voudrais évoquer moi aussi.
On peut résumer la notion de charge mentale à l’ensemble des sollicitations du cerveau pendant l’exécution du travail, sollicitations qui résultent d’une multitude de facteurs et qui sont perçues par la personne qui les subit comme une contrainte. Elle est donc à la fois objective (nombre des informations et tâches à traiter par le cerveau) et subjective (perception par la personne concernée en fonction de ses capacités de traitement desdites informations et tâches).
Comme tu l’as abordé, on comprend que l’activité de jouer peut être source de charge mentale quand on aborde des aspects organisationnels qui sont périphériques au jeu : trouver un créneau pour jouer, assurer la mise en place du jeu avant la partie, apprendre les règles, les restituer aux autres joueuses et en être la gardienne, veiller au bien être matériel des joueuses (ont-elles soif (rien de pire qu’une mauvaise bière), faim (les chips c’est pas automatique), sont-elles bien installées (cette chaise est juste une torture), la lumière est-elle suffisante (en fait il me faut une loupe parce ce que je vois rien sur ces cartes) ?).
Une fois installées autour de la table, le jeu déployé, les règles intégrées… on s’imagine souvent que la charge mentale va s’effacer d’elle-même, comme si elle appartenait au monde extérieur, à l’avant-partie. Mais parfois, c’est au cœur même du jeu que la charge ressurgit. Et ce, même quand on est prête, motivée, disponible.
Ce que je voudrais explorer ici, c’est cette forme insidieuse de charge mentale : celle qui ne vient pas de l’organisation, mais du système ludique lui-même.
Pour parler de cette charge mentale qui s’invite en pleine partie, je vais repartir de trois types de situations vécues, qui m’ont donné ce sentiment étrange que le coût mental du jeu dépassait le plaisir qu’il était censé m’apporter.
Trois cas particuliers, trois formes de charge mentale :
– Celle qui surgit dans les phases de maintenance, notamment dans les jeux narratifs ;
– Celle qui naît de l’accumulation ou de la dispersion des règles, du système proposé par le jeu lui-même ;
– Et celle, plus spécifique encore, qui s’installe dans les jeux legacy, souvent en raison d’un problème de “dosage”.
La maintenance : Fin de manche, début de migraine
La maintenance, dans un jeu de société, correspond à ces moments intermédiaires où l’on doit réinitialiser des éléments, déplacer des marqueurs, compter des ressources ou encore appliquer une série d’effets automatiques. C’est toujours une étape fonctionnelle, mais qui n’a pas exactement la même importance selon les types de jeux.
Dans les jeux compétitifs, la maintenance est souvent une phase de nettoyage : on réinitialise les ressources ou le marché de cartes, on remet les éléments en place ou on reprend nos ouvriers, on prépare la manche suivante. Ce sont des gestes techniques, neutres, parfois fastidieux, mais rarement porteurs de sens ludique. Ils peuvent être pénibles en termes de manipulation mais sont souvent conçus comme des respirations entre différentes manches.
À l’inverse, dans les jeux coopératifs, souvent narratifs, la maintenance prend souvent la forme d’un contre-jeu. Ce n’est pas seulement une phase de gestion : c’est une phase de jeu à part entière. Un moment où le jeu lui-même joue contre les joueuses.On active des ennemis, on applique des effets néfastes, on avance un compte à rebours, on tire des cartes événements.
En théorie, cela devrait être plus engageant puisque c’est du jeu. Mais en pratique, ce moment du tour est souvent le plus chargé cognitivement : il faut suivre une séquence précise, appliquer des effets parfois conditionnels, vérifier l’état de plusieurs zones ou personnages. Et là encore, si l’ergonomie ou la lisibilité ne suit pas, cette phase peut devenir lourde, confuse, et entamer le plaisir de jeu. J’adore les jeux FFG mais pourtant je suis obligée de reconnaître que ces phases de jeu deviennent de plus en plus insupportables en cours de partie (par exemple, dans Les Demeures de l’épouvante, big up à Marie-Neige, il arrive toujours un moment où je ne sais plus où on en est des tests d’horreur que doivent faire les joueuses).
Or, dans les jeux narratifs, on attend justement de l’expérience qu’elle soit fluide, presque cinématographique. Les phases de maintenance (la phase de mythe) en étant si exigeantes en viennent à briser l’immersion au moment pourtant où la tension devrait être la plus forte, et le rythme même de la partie en est cassé.
Et c’est bien pour cela que j’aime profondément Cthulhu: Death May Die. Dans ce jeu, les phases de maintenance interviennent à l’intérieur du tour de chaque joueuse et sont éclatées. Ainsi, la détermination de l’événement du tour et l’activation des ennemis se fait immédiatement après la phase d’action de la joueuse (et non pas de toutes les joueuses). S’ensuit alors la phase d’attaque des ennemis ou de loot. Puis enfin, la maintenance proprement dite (avancée du grand ancien éventuelle et gestion du feu). Le fait d’avoir cassé le rythme habituel des phases de maintenance en l’intégrant par petit morceau dans le tour de chaque joueuse permet de donner l’illusion que cette phase est assez légère à gérer et qu’elle est une véritable phase de jeu. Bien sûr le jeu est aidé en cela par des règles très épurées : il ne reste de la maintenance que l’indispensable, tout le superflu a été retiré.
La maintenance, lorsqu’elle est trop lourde ou trop fréquente est désagréable parce qu’elle interrompt le flow, qu’on peut définir comme un état d’immersion dans l’action. Le flow a été théorisé en 1975 par le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi dans son livre Flow : The Psychology of Optimal Experience : les personnes seraient plus heureuses quand elles sont dans un état de flow, cet état de concentration ou d’absorption totale dans une activité ou une action. Csikszentmihályi découpe le flow en neuf parties :
- L’équilibre entre la difficulté et les capacités,
- la fusion entre l’action et l’attention,
- la clarté des objectifs,
- un retour immédiat et sans ambiguïté,
- une concentration sur la tâche à accomplir,
- le paradoxe du contrôle,
- la transformation du temps,
- la perte de la conscience de soi-même
- une expérience autotélique.
Pour atteindre un état de flow, un équilibre doit être établi entre la difficulté de la tâche (élément objectif) et les capacités de l’exécutant (élément subjectif).
Cela peut sembler théorique, mais on le ressent très concrètement dès qu’on doit, en pleine partie, dérouler une séquence d’effets comme on lirait une fiche technique — en se demandant à chaque étape : “Et maintenant, qu’est-ce qu’on oublie ?”
Par conséquent, quand les phases de maintenance ne permettent plus cet équilibre, que l’on se retrouve en permanence à devoir reprendre le déroulé des différentes étapes comme si on lisait une note de procédure, le jeu demande alors une charge cognitive qui ne nourrit ni le plaisir ni la compréhension, mais simplement la bonne marche du système. D’autant plus quand l’ergonomie n’aide pas : jetons minuscules, couleurs difficiles à différencier, iconographie obscure… Le cerveau fatigue. Il y a là une forme de friction, une usure, qui nuit particulièrement aux profils de joueuses moins multitâches, ou à celles qui cherchent un tour de jeu “propre et lisible”.
Trop de règles tue le jeu
Certains jeux semblent vouloir prouver leur richesse par la complexité de leurs règles (la fameuse définition des jeux expert). Pas par une profondeur stratégique naturelle, mais par une accumulation d’exceptions, de cas particuliers, de sous-systèmes. Ce n’est pas la complexité en soi qui pose problème — elle peut être jubilatoire — mais la surcharge cognitive qu’elle implique quand elle devient artificielle, voire inutile.
On revient là à la définition de la fameuse élégance dans le jeu. J’ai déjà du le dire ici ou ailleurs mais il y a une différence fondamentale entre jeu complexe et jeu compliqué. Un jeu élégant n’a pas besoin de se noyer dans les détails : il propose des règles simples, claires, et une profondeur qui naît des décisions à prendre, pas du nombre de points de règles à retenir. Et quand la complexité réside dans le livret de règles plus que dans les choix proposés, on ne joue plus : on exécute, parfois sans bien savoir pourquoi, avec le sentiment désagréable qu’une erreur est toujours en embuscade
Et cette fatigue cognitive n’est pas neutre : elle agit comme un filtre, un obstacle, parfois même une barrière invisible. Elle exclut, de fait, celles et ceux qui ont des difficultés de mémorisation, ou tout simplement celles qui découvrent le jeu de société moderne. Ce n’est pas une question d’intelligence, mais de disponibilité mentale — et cette disponibilité, tout le monde ne l’a pas, en tout cas pas tout le temps.
Dans certains groupes, cette surcharge crée même une hiérarchie implicite : bien jouer, ce serait connaître toutes les exceptions (plutôt que faire des choix intelligents). Et dans ce contexte, ressentir de la charge mentale peut décourager de poser une question, de proposer une action, de s’autoriser à se tromper.
Pire encore : certains jeux deviennent des marqueurs d’appartenance à un entre-soi ludique, où l’on ne “mérite” de jouer que si l’on a franchi toutes les étapes de difficulté. Et ça, c’est un vrai problème si l’on croit à une pratique du jeu ouverte, accueillante et inclusive.
Les jeux legacy
Les jeux legacy ont cette promesse enivrante : celle d’un jeu qui évolue avec le groupe, qui se transforme à chaque partie, qui devient NOTRE jeu. Plus qu’une succession de parties, ils offrent la perspective de vivre, dans la globalité de la campagne, une expérience unique. C’est d’ailleurs pour ça que à titre personnel je n’ai aucune envie de refaire une campagne d’un jeu legacy (quand bien même j’en aurais le temps et la disponibilité) et que je pense que l’altération du jeu, sa transformation irréversible, fait pleinement partie de la proposition.
Aujourd’hui, on sait à peu près à quoi s’attendre dans les jeux legacy : ils offrent souvent un aspect narratif, tout au moins la campagne proposée essaie de nous faire vivre une histoire, de nouvelles mécaniques ou tout au moins des variations de règles vont s’ajouter, mais surtout on attend d’être surprises.
Mais ce format si séduisant repose sur un dosage très subtil pour être efficace — et c’est là que le bât blesse trop souvent.
L’ajout de nouvelles règles
De mon expérience, les ajouts de règles sont bien souvent trop nombreux, trop rapprochés, trop brutaux. On commence une campagne dans un certain état d’esprit, avec une vision claire du système. Et puis, à chaque partie ou presque, on ajoute des modules, on colle de nouvelles règles, on modifie les conditions de victoire, on introduit une ressource de plus.
On n’a pas le temps d’intégrer et de pratiquer suffisamment ces nouvelles couches de règles. À peine le temps d’expérimenter une mécanique qu’une autre arrive. Le jeu ne respire plus. Il y a une saturation cognitive, une sensation d’overdose douce — un peu comme si, à chaque fois qu’on reprenait une série, on nous changeait la moitié du casting et les règles du monde.
C’est d’autant plus frustrant que ces ajouts sont rarement hiérarchisés. Certaines règles sont centrales, d’autres anecdotiques, mais le jeu les présente toutes sur le même plan. Résultat : on ne sait plus ce qui est important, ce qui peut être oublié sans gravité, ce qui va revenir. On joue dans le brouillard, avec cette impression constante de “jouer faux”, malgré toute notre bonne volonté. On finit parfois par laisser de côté certains de ces ajouts (les satellites dans Pandemic Legacy saison 0). Dans Les Aventuriers du rail Legacy, on finissait toujours par réaliser qu’on avait oublié de jouer une des mécaniques additionnelles (mention spéciale au train fantôme).
Et c’est là que la charge mentale s’installe, insidieuse. Pas dans la stratégie ou la tension du jeu, mais dans la gestion des couches de règles superposées. Parce qu’on ne parvient à les apprendre ni théoriquement, ni empiriquement.
Une exception : My city de Reiner Knizia dans lequel le découpage du jeu en chapitre permet de s’approprier les ajouts de règles et nouveaux objectifs à un rythme adapté à l’ensemble des joueuses autour de la table, en prenant son temps, en laissant le temps de savourer les évolutions du jeu.
Quand la mise en place et la fin de partie prennent le pas sur la partie elle-même
C’est probablement une conséquence du point précédent, mais dans certains jeux legacy je me suis surprise à évaluer que les temps hors jeu (avant et après la partie) finissaient par être plus longs que la partie elle-même.
Et cette disproportion se creuse de plus en plus au fil des parties. Surtout quand on a le sentiment qu’une partie des ajouts n’apporte pas grand chose au plaisir de jeu.
C’est un déséquilibre qui altère profondément le rythme du jeu, au point de faire hésiter à lancer une nouvelle session, surtout en fin de campagne. On aime le jeu et l’expérience proposée mais on finit par se surprendre à penser qu’on aimerait bien en avoir terminé. Sachant que le sentiment de “devoir terminer” la campagne finit par également prendre le pas sur “l’envie” de terminer la campagne. Dans Clank Legacy, disons que sur les 3 dernières parties, j’en avais juste ras le bol du jeu, fondamentalement je n’avais plus envie d’y jouer et je l’ai terminé juste parce que je me disais que après 8 parties ce serait dommage de ne pas finir (et je doute que ce soit une excellente motivation pour jouer).
Par conséquent, quand la structure, le système du jeu, devient plus lourd que le plaisir qu’il apporte, quand le jeu devient une corvée, c’est la promesse du jeu qui est rompue.
Conclusion
Alors pourquoi on s’inflige ça ? Pourquoi est-ce qu’on accepte ces livrets de règles parfois indigestes, ces surcouches de règles, ces phases de maintenance interminables ? Pourquoi est-ce qu’on revient, encore et encore, à des jeux dont on sait qu’ils vont nous épuiser plus qu’ils ne vont nous épanouir ?
Parce qu’on est en quête.
En quête d’un moment rare : presque magique. On veut vivre une expérience, une aventure, quelque chose d’unique, qui nous transporte, qui nous marque, dont on se souviendra et qui n’appartiendra qu’à notre groupe de joueuses.
Et les jeux legacy, les jeux narratifs, particulièrement, nous font cette promesse. Ils nous tendent un miroir doré : viens, ça va être une expérience unique. Alors on y va. On s’accroche. On déplie, on colle, on lit, on gère. Parce qu’on espère encore que, peut-être, cette fois-ci, ce sera l’expérience ultime, cet Eldorado ludique qu’on recherche encore et encore.
Mais cette illusion a un coût. Et quand le coût devient supérieur au plaisir, il faut pouvoir se poser la question. Peut-être qu’on ne l’aura jamais, cette expérience parfaite. Peut-être qu’elle est derrière nous, ou dans un jeu plus modeste, plus humble, plus fluide.
Et ce n’est pas grave.
Rappelons nous qu’un jeu, ce n’est pas une épreuve. Que s’il nous coûte plus qu’il ne nous réjouit, alors peut-être que c’est lui qui est mal dosé, conçu — et pas nous. Et qu’on a le droit, aussi, de préférer les jeux qui prennent soin de notre bien être.
Jouer, ce n’est pas faire ses preuves. C’est juste chercher un moment de suspension, de plaisir.