
Crédits : ArtPhotoLimited
Ce texte est la transcription de la chronique proposée en podcast dans le format Pelleter des nuages (audio dispo ici).
Dans l’introduction de ce podcast, lorsque nous revenons sur le concept de Pelleter des nuages, nous disons souvent, avec un peu d’espièglerie dans la voix, que nous essayons d’analyser le jeu de société comme si nous étions des universitaires et que ce média était digne d’être observé, analysé, interprété.
La pointe d’humour que l’on peut percevoir dans cette déclaration d’intention tient probablement moins à la légitimité de ce que nous proposons de faire (je pense que toi comme moi ne souscrivons pas sérieusement au fameux ce n’est qu’un jeu) qu’à notre légitimité propre. Après tout, nous nous livrons à cet exercice à l’aune de notre expérience personnelle, qui ne repose pas sur une base théorique ou universitaire. De ton côté Christian, tu as créé des jeux, tu en as édité pas mal, ce qui te donne une expertise professionnelle indéniable. Et ce que nous avons en commun, c’est que nous aimons jouer à toutes sortes de jeux, qu’ils soient très commerciaux comme plus expérimentaux, qu’ils soient les récents bangers comme de vieux titres qui font encore un peu vibrer l’imaginaire des joueuses. Notre position de joueur et joueuse, destinataires principaux des créations ludiques, nous donne donc une certaine légitimité. Et, selon l’application du fameux principe de Kompetenz Kompetenz, nous nous déclarons compétents pour valider notre compétence à parler de jeux de société.
Je précise tout cela parce que ce qui va suivre s’inscrit pleinement dans cette démarche : une réflexion située, assumée, qui ne prétend pas à l’objectivité académique mais revendique le droit à l’analyse. En effet, dans la perspective de cette démarche qui anime Pelleter des nuages, je suis donc toujours curieuse des sujets qui évoquent la critique ludique, l’analyse, l’interprétation, la portée des jeux, bref tout ce qui renvoie à un certain caractère culturel du jeu de société. A cet égard, rappelons en aparté que cette question n’est pas juste théorique : elle renvoie à des enjeux économiques réels en France, notamment quand il s’agit de militer pour que les jeux de société soient éligibles au fameux pass culture, ou encore quand on aborde le statut social des auteurs de jeux et les questions de propriété intellectuelle.
J’étais donc très intéressée quand j’ai vu que sur son blog Bruno Faidutti avait écrit un article au titre prometteur Comment et jusqu’où peut-on et doit-on analyser les jeux ? Bien que je connaisse les positions de Bruno sur ce sujet et que je ne pouvais pas être étonnée du ton de cet article, je suis tout de même ressortie agacée de ma lecture non pas parce qu’il refuse l’analyse, mais parce qu’il en fixe les limites d’une manière qui me pose problème.
C’est dans ce contexte que je voudrais aujourd’hui m’arrêter sur un texte précis, non pas pour le contester frontalement, mais pour m’en servir comme point de départ d’une réflexion plus large.
Avant toute chose, il faut savoir que j’aime énormément Bruno Faidutti et que j’ai beaucoup d’estime pour lui. Je l’apprécie en tant qu’auteur évidemment, mais avant tout en tant que personne humaine car, et bien que je ne sois pas toujours en accord avec ses opinions, c’est quelqu’un qui est ouvert à la discussion, au débat, et qui dans le paysage francophone encombré de unboxing et de propos promotionnels est une des rares personnes à avoir proposé une réflexion autre sur le jeu de société.
On peut profondément apprécier quelqu’un, et être en profond désaccord avec certaines de ses positions. C’est même souvent le signe qu’on prend ces positions au sérieux. C’est précisément dans cet esprit que s’inscrit cette chronique : pas tant pour répondre directement à la chronique de Bruno (même si forcément certains de nos arguments se feront écho (Eco ?)), que pour ouvrir le sujet sur d’autres pistes de réflexion. Car si nous partageons quelque chose avec Bruno Faidutti c’est bien l’amour du jeu de société mais aussi l’amour du débat.
Analyse et surinterprétation
Dans son article, Bruno Faidutti ne condamne pas par principe l’analyse et l’interprétation des jeux de société. Il prend d’ailleurs soin de le préciser dans sa conclusion, lorsqu’il écrit qu’il est « parfaitement légitime, et souvent intéressant et amusant, d’analyser les jeux de société », et que cette démarche peut nous aider à mieux les comprendre, voire à concevoir de meilleurs jeux à l’avenir. La mise en garde qu’il formule porte ailleurs : sur le risque de la surinterprétation, et surtout sur la tentation de prendre nos analyses trop au sérieux, au point de croire qu’elles livreraient une forme d’essence du jeu.
Ce qu’il critique c’est une certaine forme d’intentionnalisme (l’idée selon laquelle analyser un jeu consisterait à rechercher une intention consciente, délibérée, de son auteur, puis à en tirer des conclusions interprétatives parfois très éloignées de ce que celui-ci avait en tête). Cette critique s’appuie notamment sur deux arguments. D’un part, de nombreux auteurs – notamment dans le domaine littéraire – ont refusé une surinterprétation de leur oeuvre. D’autre part, dans le domaine du jeu de société, selon Bruno Faidutti, L’auteur n’a souvent pas d’autre intention que de faire un jeu excitant et intéressant, sans chercher à véhiculer un discours ou un message particulier.
Ces arguments sont parfaitement compréhensibles, et même largement recevables. Pourtant, ils reposent sur une conception de l’analyse et de l’interprétation qui me semble profondément réductrice : celle qui les assimile presque exclusivement à la recherche de l’intention de l’auteur. Or, selon moi, analyser un jeu ne se résume pas — et ne s’est jamais résumé — à cette quête.
Invoquons Umberto Eco un instant. Une personnalité qui, à l’instar de Pierre Bourdieu, peut toujours être invoquée sans grande prise de risque. Umberto Eco a publié plusieurs ouvrages intéressants sur la question de l’herméneutique, c’est à dire de l’interprétation des textes, et notamment L’oeuvre ouverte en 1965 et Les limites de l’interprétation en 1992.
Résumons, probablement à l’extrême, les idées avancées par Eco dans ces ouvrages.
Dans L’Œuvre ouverte, Eco place clairement le lecteur au centre du processus interprétatif. L’œuvre n’est pas un objet clos : elle demande à être actualisée, complétée, mise en mouvement par son récepteur. Le sens n’y est pas donné une fois pour toutes ; il est pluriel, latent, et nécessite un effort d’interprétation. Il est d’ailleurs significatif qu’Eco parle d’« œuvre » et non d’« auteur » : ce qui compte, ce n’est pas ce que l’auteur a voulu dire, mais ce que l’œuvre permet de faire.
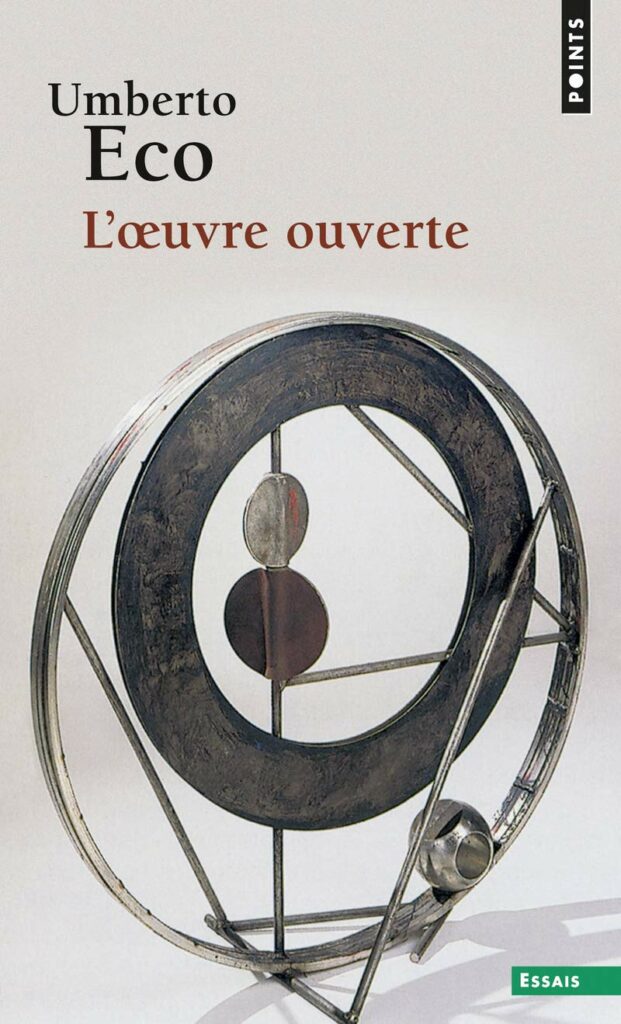
Dans Les Limites de l’interprétation, Eco nuance cette position, sans pour autant la renier. Il rappelle qu’interpréter ne signifie pas faire abstraction de tout : ni du sens littéral, ni du contexte historique, ni des règles internes du langage ou du système étudié. Lire entre les lignes n’implique pas de lire n’importe quoi. Il existe des interprétations abusives, non parce qu’elles trahiraient l’intention de l’auteur, mais parce qu’elles ne résistent pas à l’épreuve du texte lui-même.
C’est précisément là que réside le point crucial. Les Limites de l’interprétation ne marque pas un revirement dans la pensée d’Eco. Au contraire, il y distingue trois notions essentielles : l’intention de l’auteur, l’intention du lecteur, et surtout l’intention de l’œuvre. Lorsque Eco parle de limites, il ne les situe pas du côté de ce que l’auteur aurait voulu dire, mais du côté de ce que l’œuvre permet raisonnablement de soutenir. Ce sont les structures internes du texte — ou, dans notre cas, du jeu — qui posent des contraintes à l’interprétation.
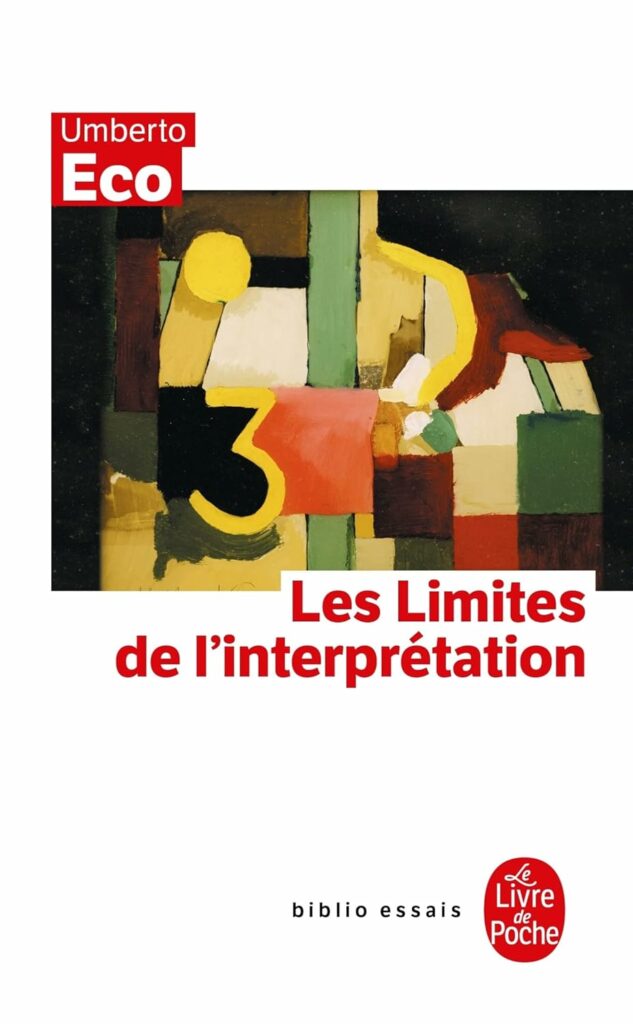
C’est en ce sens qu’Eco rejette l’opposition simpliste entre objectivité et subjectivité. L’interprétation n’est ni une pure projection arbitraire, ni une extraction mécanique d’un sens caché. Elle est un dialogue entre une œuvre et son récepteur, dialogue encadré, contraint, mais bien réel. Et c’est précisément cet espace-là que l’assimilation de l’analyse à la surinterprétation tend à effacer.
Eco parle principalement des ouvrages littéraires mais cette analyse trouve tout autant à s’appliquer aux jeux de société. Peut-être encore mieux au jeu.
Le jeu de société — parce qu’il est un système de règles, une machine à produire des comportements — est encore plus proche de cette idée que le roman. Dire que « le jeu est une machine à créer des expériences » est juste. Mais alors il faut en accepter la conséquence logique : une machine à créer des expériences crée aussi des cadres producteurs de sens.
Et c’est précisément ce que l’analyse critique actuelle (Mary Flanagan, Amabel Holland, Henri Kermarrec pour reprendre celles et ceux que cite Faidutti, mais on pourrait probablement en ajouter et je vous laisse compléter) cherche à comprendre. Réduire les démarches d’analyse du jeu de société à celles que l’on retrouverait dans le monde littéraire me paraît incomplet. Il n’y a pas de hiérarchie implicite entre littérature et jeux de société qui reposerait sur la profondeur de l’une au détriment de l’autre, sur ses qualités romanesques ou littéraires.
La profondeur d’un jeu ne se mesure pas à sa capacité à raconter une histoire, mais à la manière dont il organise des systèmes, des choix, des contraintes, des relations.
C’est exactement la position d’Amabel Holland pour qui le jeu n’est pas un texte à lire mais un dispositif à expérimenter, un système qui produit des effets, des tensions, des normes.
La critique ludique contemporaine ne réduit pas l’analyse, la recherche de sens, la lecture politique des jeux à une quête d’intention consciente de l’auteur. Quand Mary Flanagan ou Amabel Holland parlent d’oppression, de fantômes idéologiques ou de structures implicites, elles ne disent pas : « l’auteur a voulu dire que » mais « voilà ce que le système produit, permet, normalise ».
Un jeu est un jouet. Et alors ?
Dans la vidéo d’Amabel Holland intitulée Mechanisms as metaphors, on peut voir un extrait d’une vidéo de The Dice Tower de juin 2024 dans laquelle Tom Vasel et Zee Garcia, à propos de trois jeux « prétentieux », se gaussent et martèlent quelque chose comme “ Les jeux de société sont des jouets. Vraiment. Il ne faut pas faire semblant que ce soit autre chose. Ce jeu ne change pas des vies.”
Dire que les jeux sont des jouets n’est pas une simple blague, une punchline bien sentie exprimée par Tom Vasel. D’ailleurs à ce moment de la vidéo, il est extrêmement sérieux. Non, dire que les jeux sont des jouets est utilisé comme un argument qui clôt toute discussion : inutile d’analyser, inutile de questionner, inutile de politiser. Ce n’est qu’un jouet, ce n’est qu’un jeu.
Dire que le jeu est un jouet pour clore le débat est bien lapidaire. En premier lieu, c’est méconnaître le fait que les jouets sont des objets culturels chargés de sens, qui sont depuis longtemps étudiés et analysés, qu’il s’agisse des poupées, des figurines ou des jeux libres pratiqués par les enfants.
On peut asséner qu’un jeu est un jouet sans que cela annule le fait qu’il organise des comportements, distribue des rôles, hiérarchise des valeurs ou rend certaines actions désirables et d’autres impossibles. Le mot jouet semble utilisé non pour décrire mais pour infantiliser. Et pour caricaturer la recherche d’analyse et de sens.
Un autre exemple de cette volonté de caricaturer est présenté dans la vidéo. Elle reprend l’exemple très connu des “rideaux bleus” et je crois que nous en avons déjà parlé. Imaginons un livre dans lequel un passage évoque des rideaux bleus. Une analyse que l’on pourrait en faire, comme on en faisait sur les bancs de l’école, serait que les rideaux représentent l’immense dépression du personnage. Alors que ce que l’auteur voulait dire, c’est juste que les rideaux étaient bleus.
Cette blague a évidemment pour objectif de ridiculiser celles qui se croient trop intelligentes et cherchent à interpréter, voire surinterpréter, principalement en se plaçant du point de vue de l’auteur. Pourtant, là encore on est dans la caricature.
L’analyse contemporaine ne prétend jamais que l’auteur, en choisissant des rideaux bleus, a voulu consciemment symboliser quelque chose. C’est peut-être le cas mais ce n’est pas le point important. Ce que dit l’analyse c’est que le choix de cette couleur produit comme effet, comme sentiment, comme sensation.
Le mythe des rideaux bleus révèle surtout une peur fantasmée de l’école, bien plus qu’une critique de l’analyse et de l’interprétation. Cette vision révèle une méfiance envers l’intellectualisation et prône une certaine ignorance comme vertu.
Ainsi, trop réfléchir serait suspect, analyser serait élitiste, ressentir serait plus pur que comprendre. Il s’agit en réalité d’une esthétisation de l’ignorance vue comme une forme de pureté originelle : ne pas savoir et ne pas questionner garantiraient une plus grande authenticité.
Pour certains, cette défense de l’ignorance permet aussi de conserver les fonctions essentielles du jeu, à savoir l’évasion et le divertissement. Pourtant, faire prévaloir systématiquement ces deux fonctions, en excluant toute autre recherche dans le jeu, n’est pas la défense du plaisir mais plutôt du statu quo. Car celle qui refuse l’analyse n’a jamais à justifier ses choix, n’a jamais à entendre les expériences des autres (surtout si elles sont en dissonance avec les siennes), n’a jamais à se confronter à ce que les jeux produisent comme effets dans le monde.
Le rejet de l’analyse n’est donc pas une défense du jeu compris comme plaisir et divertissement mais une défense de l’irresponsabilité. Il permet ainsi de ne pas avoir à regarder de trop près ce que l’on fabrique et ce que l’on consomme.
Responsabilité
Dire « je n’avais pas de propos », « je n’avais pas d’intention » n’est pas neutre. C’est une posture. Et une posture extrêmement commode, car elle permet à la fois d’échapper à la critique, de disqualifier celles qui analysent — vous surinterprétez Madame ! — et de se présenter comme un simple artisan du plaisir ludique, dégagé de toute portée symbolique.
Or créer sans intention consciente ne veut pas dire créer sans effets. Les systèmes produisent du sens quoi qu’il arrive — non pas parce que l’auteur l’a voulu, mais parce que le jeu est un dispositif. Un ensemble de règles, de contraintes, d’objectifs, de récompenses, qui organise des comportements et oriente des choix. Le sens n’est pas toujours intentionnel ; il est souvent structurel.
Marteler qu’on n’a rien voulu dire, qu’on n’avait pas d’intention, devient alors une manière de s’exonérer de toute responsabilité. Pourtant, il existe une différence fondamentale entre intention et responsabilité : l’absence de l’une ne permet pas d’effacer l’autre. On peut parfaitement admettre qu’un auteur n’a pas voulu faire un jeu colonialiste, sexiste, validiste ou capitaliste. Mais cela ne suffit pas à clore la discussion. Car la question critique n’est pas tant : qu’as-tu voulu dire ? que : qu’est-ce que ton jeu rend possible, valorise, normalise, invisibilise ?
La posture du « je n’avais aucune intention » devient alors une manière de dire : je refuse d’assumer les conséquences symboliques de ce que j’ai fabriqué. Non pas parce qu’elles seraient nécessairement graves ou condamnables, mais parce qu’elles existent indépendamment de toute volonté consciente.
Dire que le jeu est un monde clos, que l’on y joue pour sortir du réel et qu’il ne faut pas y chercher de profondeur, revient à adopter une vision fonctionnaliste et apaisante du jeu. Une vision qui rassure, parce qu’elle maintient une frontière nette entre le jeu et le monde. Or cette frontière est largement illusoire.
Le travail de nombreuses personnes — Mary Flanagan, Brenda Romero, Amabel Holland, Henri Kermarrec, et aussi, à notre échelle, ce que nous tentons de faire avec Pelleter des nuages — montre au contraire que le jeu n’est pas hors du monde. Il en est une forme condensée. Un espace où les rapports de pouvoir, les normes sociales, les exclusions peuvent être rejoués, déplacés, parfois rendus visibles précisément parce qu’ils sont mis en système.
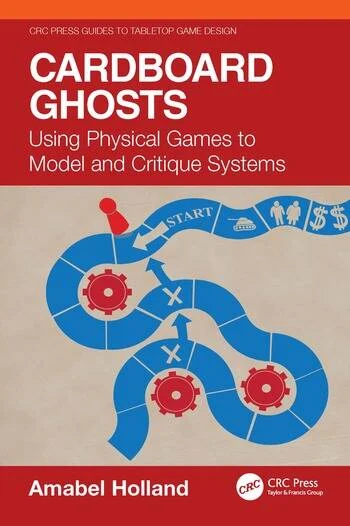
Le droit revendiqué à l’inconscience, au simple divertissement, révèle également une forte asymétrie. Cette posture n’est pas accessible à tout le monde de la même manière. Se dire que l’on fait « juste un jeu pour s’évader », dans lequel il ne faudrait pas trop chercher de sens, est souvent un privilège : celui de ne pas être directement affectée par ce que le jeu représente, ce qu’il ignore, ou ce qu’il reconduit comme norme implicite.
Qualifier l’analyse de surinterprétation paranoïaque revient alors, d’une certaine façon, à nier ce que d’autres vont ressentir, percevoir, éprouver face au jeu. Car nous ne pouvons pas toutes nous évader de certaines représentations. Pour certaines joueuses, le jeu n’est pas un ailleurs neutre, mais un espace où se rejouent des expériences déjà vécues.
La critique et l’analyse ne se positionnent jamais comme des entraves à la création. En revanche, elles obligent à assumer cette création, et à accepter de la penser même après coup. Créer sans enjeu déclaré, sans propos assumé, ce n’est pas la liberté artistique. C’est une liberté sans retour, sans dialogue, sans responsabilité.
Il y a là un paradoxe difficilement tenable : refuser l’analyse de ses créations tout en revendiquant le droit de créer des systèmes qui agissent sur les joueuses.
Conclusion
Analyser, le jeu, l’interpréter et peut-être oui parfois le surinterpréter n’est pas tuer le plaisir ou transformer le jeu en objet sacré. Penser n’empêche pas de jouer, analyser n’empêche pas de ressentir. Au contraire, l’analyse enrichit le plaisir lié au jeu.
L’analyse et l’interprétation sont fortement liées selon moi à ce qu’on appelle la critique et qu’on a toujours du mal à définir. Je tenterai donc une petite définition personnelle, probablement très inspirée d’un mélange de sources dont j’ai pu m’imprégner sur le sujet.
La critique d’une oeuvre, qu’on parle de jeux, de littérature, de cinéma, n’est pas que la simple justification vaguement argumentée et prétendument objective. C’est aussi un éclairage éminemment subjectif donné à une oeuvre qui se fonde sur des éléments objectifs et des ressentis subjectifs. C’est la proposition d’une grille de lecture de l’oeuvre qui inclut nécessairement des éléments d’interprétation.
Proposer une telle critique d’un jeu n’induit pas d’imposer aux autres sa perception d’une oeuvre. C’est plutôt l’ouverture à un débat. Nous avons déjà cité dans cette émission un article de Dan Thurot à propos de Battlestar Galactica et de sa rethématisation lovecraftienne dans L’insondable. C’est probablement la meilleure critique de jeu de société que j’ai lue. Cette critique s’ouvre par un long passage dans lequel Dan évoque le 11 septembre 2001 et l’impact que cet événement a pu avoir pour lui alors qu’il était adolescent, puis en quoi Battlestar Galactica le jeu de société rend compte de la situation psychologique et émotionnelle de l’Amérique post 11 septembre.
Je suis européenne, j’avais 23 ans en 2001. Ce que retranscrit Dan Thurot, je n’aurais probablement pas pu le toucher du doigt moi-même. Mais lire son analyse, sa critique du jeu (qui ne se résume pas à savoir si BSG est un bon jeu ou pas) m’enrichit. Enrichit ma vision du jeu. Enrichit ma compréhension de Dan Thurot en tant que chroniqueur ludique. Enrichit ma vision du monde.
Je suis athée, je n’en ai jamais fait mystère. Bien sûr je ne peux pas nier que je suis de tradition chrétienne, au sens culturel et non religieux, parce que je vis dans un pays, qui malgré la loi de séparation de l’église et de l’état continue de favoriser la culture chrétienne de façon plus ou moins inconsciente. Mais pas religieux parce que depuis déjà la génération de mes grands-parents, tout le monde dans ma famille est globalement athée.
Un jour, dans une discussion concernant le deuil et la perte de proches, une personne m’a fait cette réflexion : cela doit être difficile d’être athée, de se dire qu’il n’y a pas de vie après la mort, comment on donne du sens à la vie ?
Justement, je pense que notre existence n’a pas de sens. Ou plutôt que le monde dans lequel on vit existe par hasard et n’est pas le dessein d’une volonté divine qui nous dépasserait. Je pense que le seul sens qu’on y trouve est le sens que nous les humains donnons par nos actes. Et c’est peut-être parce que moi aussi je cherche un sens à nos actes que j’aime analyser et interpréter les créations humaines plutôt que le dessein de Dieu ou d’un quelconque grand architecte qui me dédouanerait de ma propre responsabilité.






