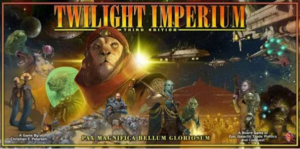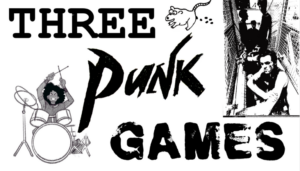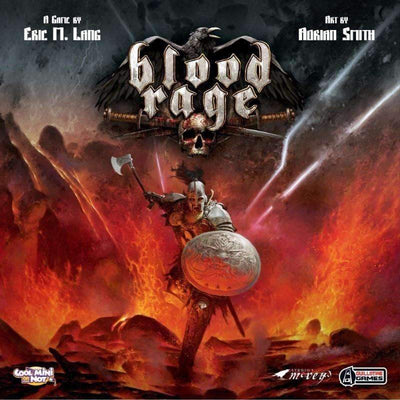
Ce texte est la transcription de la chronique proposée par Christian Lemay en podcast dans le format Pelleter des nuages (audio dispo ici).
Il y a bien longtemps que je souhaite analyser la production d’un auteur, repérer ses tics créatifs et identifier ce qui constitue sa signature ludique. Toutefois, comme cela m’amènerait à produire un long mémoire de maîtrise, plus d’une centaine de pages, je m’en suis toujours abstenu. C’est en jouant à plusieurs jeux d’Eric Lang que l’idée m’est venue non pas de décortiquer l’ensemble d’une œuvre, mais plutôt un seul élément récurrent de celle-ci.
L’auteur
D’origine montréalaise, Eric Lang s’est fait connaître comme auteur de jeux à licences: Cthulhu, Star Wars, Marvel, Game of Thrones, Le seigneur des anneaux, et j’en passe. Il a touché à de nombreux genres: les jeux de cartes à collectionner (Warhammer: Invasion), jeux de plateaux classiques (Arcadia Quest), jeux de figurines (A song of Ice and Fire), jeux de dés (Dice Masters), jeux d’ambiance (Secrets), et des jeux familiaux (Life in Reterra)…
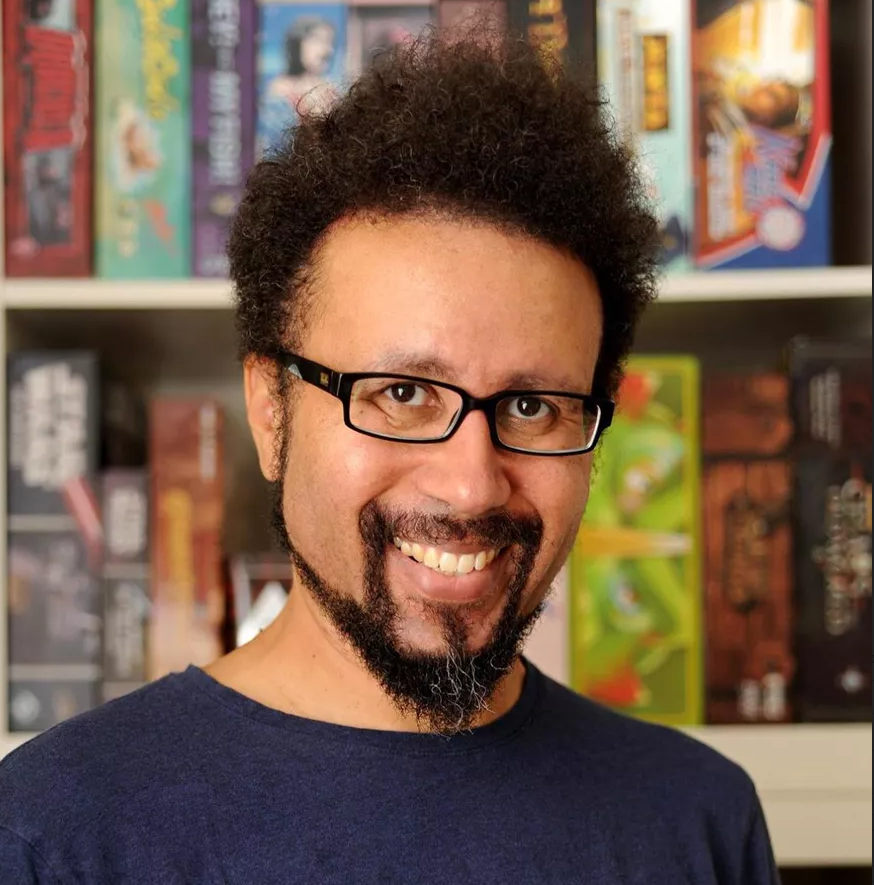
Ses jeux comportent souvent des combats et plusieurs de ceux-ci, notamment ceux de Star Wars – The Card game, Blood Rage et Le parrain, comportent un mécanisme de choix simultané lors de la résolution. Qu’est-ce que j’entends pas là? Qu’une fois identifiées les forces en présence, les belligérants choisissent un modificateur secret qui transformera l’issue du combat. Cette étude portera sur trois jeux connus sous le nom officieux de la trilogie des dieux. Il m’est apparu que ces trois titres formaient un tout, un cycle complet, à la fois suffisamment cohérent et varié pour être fouillé. Et surtout, surtout… Si le cinéma a produit d’innombrables trilogies, elles demeurent bien trop rares dans le jeu de société (tiens… un nouveau sujet de chronique?!).
Les jeux à l’étude
La trilogie des dieux tire son nom du fait que chacun des jeux qui la compose fait appel à une mythologie distincte: viking, japonaise et égyptienne.
Publiés chez CMON entre 2015 et 2021, avec trois ans d’écart entre chacun (comme la sainte trilogie), le triptyque que forment Blood Rage, Rising Sun et Ankh appartiennent à la catégorie des jeux dudes on a map ou troops on a map, que je traduirais par “troupes en guerres”, des jeux où chaque joueuse contrôle une armée composée d’unités qu’elle déploie et déplace sur une carte divisée en régions. Le but étant d’attaquer les unités adverses et conquérir des territoires; vous connaissez tous Risk, conçu par le français Albert Lamorisse et d’abord paru sous le titre de La conquête du monde vers la fin des années 1950. Dans ce type de jeux, mieux vaut ne pas trop s’attacher à ses petites unités, car elles vont mourir, souvent!
Dans Blood Rage, les joueurs incarnent un chef de clan viking à l’approche du Ragnarok, l’équivalent de la fin du monde. Pour gagner, il faut accumuler le plus de gloire possible par la bataille, l’accomplissement de quêtes et même par la mort!
Dans Rising Sun, les joueurs jouent chacun le rôle d’un Shogun dans un Japon féodal fantastique. Les points de victoire s’accumulent par la bataille, mais également par la réalisation de certaines actions.
Dans Ankh, les joueuses incarnent des dieux égyptiens cherchant à accumuler plus de dévotion que les autres afin de survivre au passage du polythéisme au monothéisme. Celle-ci s’acquiert principalement par le contrôle de lieux de culte et un peu par la guerre.
Bien qu’ils présentent des différences que je soulignerai dans cette analyse, ces trois jeux se ressemblent, s’adressent à peu près au même public. Ce sont trois nuances de rouge… sanglant.
Les combats constituent les moments forts des parties, riches en émotions, car leur issue et les conséquences s’avèrent imprévisibles, contrairement à d’autres jeux comme les échecs, le Civilization de Francis Tresham ou Imperial 2030 de Mac Gerdts, où l’on connaît très précisément le résultat d’un combat avant même de l’engager. Chez Lang, même si vos troupes surpassent largement celles de votre adversaire, celui-ci peut décimer votre armée grâce à ses modificateurs de combat, cet élément que tous choisissent secrètement et puis révèlent simultanément. Ils constituent par conséquent une grande partie du sel du jeu. Ils génèrent énormément d’incertitude… et des montagnes russes émotives!
Il y a presque toujours quelque chose à tirer d’un combat. C’est là tout le génie de cet auteur, l’issue des batailles n’est pas binaire. À Risk, si tu perds une bataille, tu t’éloignes des conditions de victoire, et on t’enlève des moyens de réussir, car tu généreras moins de troupes. Winner takes all, comme diraient les Chinois ! Dans Rising Sun, vous pouvez en remporter une bataille, mais en retirer moins dans l’économie globale de la partie qu’un autre joueur. Les batailles sont multidimensionnelles, et tout ça passe, encore une fois, par les effets des modificateurs de combat.
Interrogé au sujet de l’utilisation de ce mécanisme, l’auteur m’a confié que oui, il savait ce qu’il faisait. C’était intentionnel de mettre des choix simultanés.
Il veut des jeux avec du chaos. Il n’aime pas quand on peut tout calculer, parce que si le jeu offre cette possibilité, il se sent obligé de le faire. Il veut forcer les joueuses à jouer intuitivement.
Entrons maintenant dans le vif du sujet et examinons ces modificateurs de combat.
Nature du modificateur de combat
Blood Rage et Ankh fonctionnent selon la recette éprouvée de la carte de combat jouée face cachée, que l’on a souvent vue, notamment dans Dungeon Twister (2004) et A Game of Thrones – le jeu de plateau (2003). Ces cartes modifient le combat de deux façons.
a) elles augmentent la puissance de votre armée;
b) elles génèrent des effets instantanés comme l’obtention de points de victoire supplémentaires en cas de victoire militaire, la destruction d’une troupe adverse, la construction d’un monument, etc.
Rising Sun emprunte un chemin moins fréquenté (sauf dans Cry Havoc, paru chez Portal Games en 2016): on exécute simultanément quatre enchères cachées pour obtenir autant de privilèges en misant secrètement des pièces de monnaie.
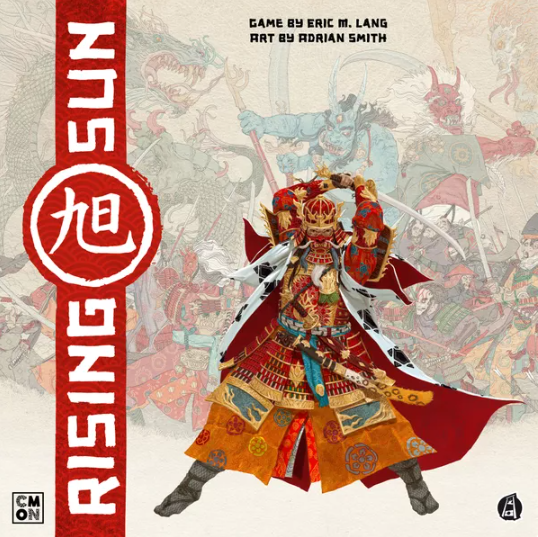
D’abord le SEPPUKU. Celle ayant misé le plus de pièces peut sacrifier toutes ses figurines en échange d’un point de victoire chacune.
Ensuite la PRISE D’OTAGE permet de prendre une figurine à un adversaire et un point de victoire au passage.
Puis L’ENRÔLEMENT DES RONINS permet d’ajouter ses pions ronins à sa Force militaire.
Enfin, le dernier bonus, celui des POÈTES IMPÉRIAUX, procure un point de victoire par figurine tuée dans le combat.
Là où Blood Rage et Ankh posent un dilemme plutôt binaire, “mon adversaire va-t-il tenter de gagner ou perdre cette bataille?”, Rising Sun nous place devant un choix bien plus complexe, aux multiples possibilités. On se demande plutôt “quels éléments puis-je ou dois-je absolument obtenir et lesquels puis-je concéder?”
Si une carte combat de Blood Rage indique +4 à votre force… elle ajoute 4 à votre force. Il n’y a pas de grand mystère. C’est plus fort que +3 et c’est moins que +5. La question reste simple: “dois-je jouer ma carte ou pas?”
Posséder six pièces à Rising Sun vaut mieux que quatre, il n’y a pas de doute, mais il s’avère possible, en lisant bien les intentions de l’adversaire, ou simplement en étant chanceux, que quatre pièces rapportent plus! Bref, l’impact et la valeur des pièces se mesurent beaucoup plus difficilement, demeurent plus abstraits.
ALERTE
Je vous ai annoncé en intro une analyse d’un élément récurrent de l’oeuvre de Lang, et je l’ai faite. À la relecture, ça m’a paru une longue énumération purement descriptive et assez chiante. Alors j’ai entièrement récrit la suite à partir d’ici. Je mettrai la première version en annexe! J’utiliserai les données que j’ai collectées pour illustrer comment différents contextes mathématiques et économiques génèrent différentes émotions. Disposer de 3 jeux ayant beaucoup en commun – il faut comparer des pommes avec des pommes dit-on au Québec – me permettront de comprendre certains principes.
Première observation
L’économie encadrant les modificateurs de combat aura un impact sur le niveau d’intensité de votre émotion. Plus un modificateur est rare, plus l’émotion au moment de le jouer sera élevée.
Trois critères qualifient la rareté de modificateurs de combat.
1- leur coût
2- leur réemploi
3- leur unicité
Dans Ankh, chacun reçoit d’emblée des mêmes cartes de combat. Vous n’avez pas besoin de travailler pour les obtenir. De plus, elles ne sont pas perdues après usage. Elles vont dans une défausse personnelle après le combat et vous pouvez les récupérer.
Comme tous disposent du même ensemble de cartes, elles n’ont pas ce petit quelque chose de spécial. Vous n’éprouvez pas la satisfaction d’être le seul autour de la table à pouvoir jouer ce coup.
Au contraire, dans Blood Rage, il vous faut drafter les cartes de combat. Elles ont un coût d’opportunité. Prendre celle augmentant de 5 votre puissance signifie renoncer à une autre carte, comme cette quête qui aurait pu vous rapporter 8 points de victoire.
Ensuite, vous ne pouvez récupérer vos cartes combat que si vous perdez le combat.
Enfin, les cartes combat d’un âge sont presque toutes différentes.
Le modificateur de combat de Blood Rage se situe plus haut dans l’échelle de rareté que Ankh… et force est d’avouer que l’intensité de l’émotion, au moment de le jouer, est plus élevée.
Ces conditions mathématiques font en sorte que ça pince moins de jouer ses cartes de combat dans Ankh que dans Blood Rage.
Toutefois, c’est dans Rising Sun que le degré de rareté du modificateur de combat atteint des sommets.
Les pièces de monnaie ont un coût élevé, car il faut mettre en place des conditions assez complexe pour les récolter.
Elles ont également un coût d’opportunité, car elles servent à payer 1001 autres éléments de jeu.
Et enfin, les pièces dépensées en combat sont non seulement toujours perdues, que vous remportiez ou non la bataille, mais les perdants se partagent la mise du gagnant. Bref, en dépensant pour gagner, vous financez la revanche de vos adversaires!
Par conséquent, chaque centime dans Rising Sun représente une partie même de votre sang! Chaque pièce fait mal. Et je crois que cette émotion, elle trouve sa source dans l’économie du jeu, dans ses mathématiques.
Deuxième observation
Plus le pourcentage de la puissance totale de mon armée provient du modificateur de combat, plus l’issue en est incertaine et plus l’émotion est intense au moment de déclencher ledit combat. Jusqu’à un certain seuil…
Dans Blood Rage et Rising Sun, le modificateur de combat peut compter pour un bon 50% de votre puissance. Par exemple, vos troupes ont une force de 4 et vous jouez une carte valant 4.
Dans Ankh, on observe une réduction notable de l’impact du modificateur de combat. Seulement 3 des 7 cartes de votre main affectent votre force. Deux d’entre elles accordent un maigre +1 de force et la dernière +3, sur des batailles où il n’est pas rare de voir des forces de base (les figurines) de 4 ou 5. Bref, on peut établir une moyenne d’impact sous les 20%. Par conséquent, nous avons une meilleure prévisibilité.
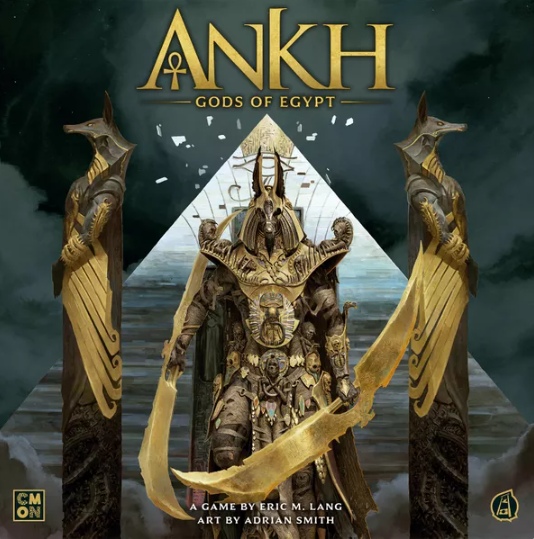
On a moins l’impression de sauter dans le vide que dans Blood Rage et Rising Sun.
Le calcul de ces pourcentages m’ont rappelé mes parties de la toute première édition du jeu A game of thrones. La faiblesse relative des armées en regard des modificateurs de combat m’avait marqué dès 2004. En effet, la puissance de la carte jouée dépassait souvent celle des troupes en présence, comptait pour plus de 50 % de votre puissance totale; par exemple, vous avez des troupes avec 2 de puissance et vous jouez une carte qui ajoute 4. Ceci créait une cassure. En effet, le jeu me demandait des efforts considérables de planification afin de recruter et déplacer mes troupes efficacement, mais toutes ces intenses réflexions et calculs stratégiques ne comptaient que pour une petite partie du résultat. Le jeu et l’enjeu ne se situaient pas au même endroit, ce qui m’amenait à me désengager.
Mathématiquement, on avait trop étiré l’élastique.
Interprétation
Blood Rage m’apparaît comme le jeu qui plaira à ceux désirant une bonne rigolade provoquée par une baston “à l’ancienne”, pas trop casse-tête. Le genre de plaisir coupable, presque adolescent. Vous vous amusez sur le champ de bataille.
Rising Sun s’adresse aux esthètes. Aux gens plus raffinés. Aux spéculateurs, ceux qui aiment que les mathématiques soient tellement vastes et complexes qu’on ne peut tout calculer et qu’on se voit forcé d’y aller à l’intuition, en artiste. Un exemple? Il y a pas moins de 29 façons différentes de répartir vos pièces si vous en possédez seulement 3, un bien maigre pécule – j’avais juste la flemme de calculer les possibilités avec 4 ou 5 pièces, voire 6.
Ankh me semble le jeu qui plaira le plus à ceux qui aiment prévoir, qui apprécient un plus grand contrôle. D’autant plus que vous marquez vos points de majorité associés à la présence de vos troupes et de vos constructions AVANT les combats, donc avant la possibilité de tout perdre! Vous avez une sécurité que vous ne trouvez pas dans les deux autres.
Eric Lang m’a confié avoir travaillé depuis une perspective de plus en plus haute, pour chaque titre. D’abord le chef guerrier qui combat avec ses troupes sur le champ de bataille, puis le politicien à l’abri dans son palais, et enfin le dieu dans le ciel.
Effectivement, dans Ankh, puisque votre point de vue est plus éloigné, les choses semblent se déplacer plus lentement, comme quand on regarde un avion dans le ciel, qui semble se déplacer à pas de tortue alors qu’il file à 600 km/h.
Conclusion
Je voulais analyser la production d’un auteur, je n’avais pas choisi la bonne échelle. En chemin, je suis rendu compte que c’était l’occasion parfaite de mesurer comment les mathématiques créaient ou influençaient les émotions ressenties.
Les mathématiques ne se résument pas à “cette tuile coûte 2 pierre 1 bois et rapporte 5 points”. C’est bien plus large. C’est toute l’économie, avec ses notions d’offre, de demande, de coût, et pas seulement les valeurs numériques. C’est aussi la qualité de l’information disponible, la part de hasard, la part d’incertitude, la possibilité de rejouer ou pas un modificateur de combat. Il y a des questions mathématiques jusque dans le plateau de jeu d’un Cranium et de Mario Party ! Combien de cases compte celui-ci ? Combien de coups faudra-t-il jouer avant de terminer la partie ? C’est encore des maths !
Bien sûr il faut une part indéniable de sensibilité et d’empathie pour faire un bon jeu, voir quand les joueuses sont engagées, ou pas. Il n’en reste pas moins que le développement de jeu, c’est trouver des solutions mathématiques à des problèmes émotionnels. Savoir doser la frustration des joueuses, créer un manque, une envie, la surprise, voire l’humour (!), récompenser suffisamment, sans excès, au bon rythme, grâce aux bonnes quantités, coûts, types d’information. Et c’est fascinant!