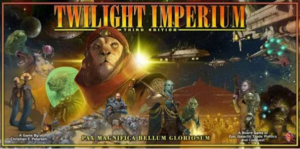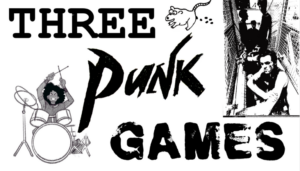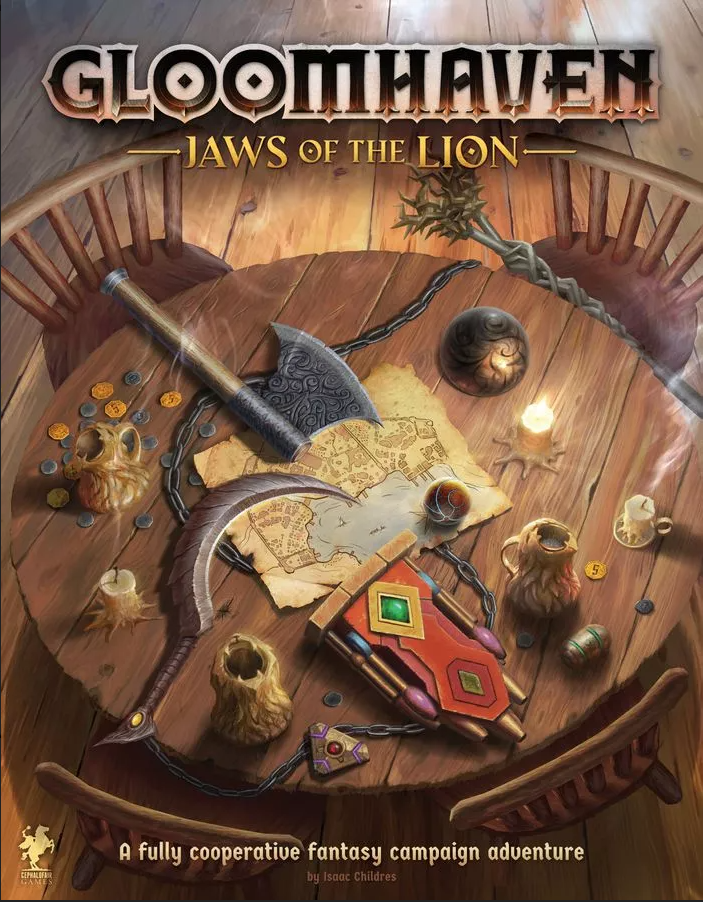
Ce texte est la transcription de la chronique proposée en podcast dans le format Pelleter des nuages (audio dispo ici).
Cet été, j’ai fait des trucs de dingue. Déjà je suis allée à la Gen Con, ce qui était une expérience assez folle, mais ce n’est pas de ça dont je veux te parler (ça aurait un peu sonné sujet de rédaction de primaire, tu sais le fameux : Racontez votre meilleur souvenir de vacances).
En fait, cet été, j’ai commencé à jouer à Gloomhaven: Les Mâchoires du lion, étant précisé que je n’ai encore jamais joué à Gloomhaven tout court. Parallèlement, j’ai aussi commencé à jouer à Baldur’s Gate 3, sur les conseils de Mad’ à qui j’en profite pour faire un big up.
J’ai adoré Baldur’s Gate 3, je n’avais pas ressenti quelque chose comme ça depuis bien longtemps en jouant à ce type de jeu. J’ai été totalement happée par l’expérience proposée : je n’avais plus envie de dormir, de manger, je voulais juste y jouer, des heures d’affilée, exactement comme lorsque j’ai joué à Skyrim il y a plus de 10 ans (sauf qu’à cette époque j’étais en congé maternité et je n’avais alors vraiment rien d’autre à faire). J’étais plongée dans l’aventure et pourtant je ne suis pas du tout fan des combats en tour par tour proposés par le jeu qui reposent sur une optimisation et laissent peu de place à une approche instinctive.
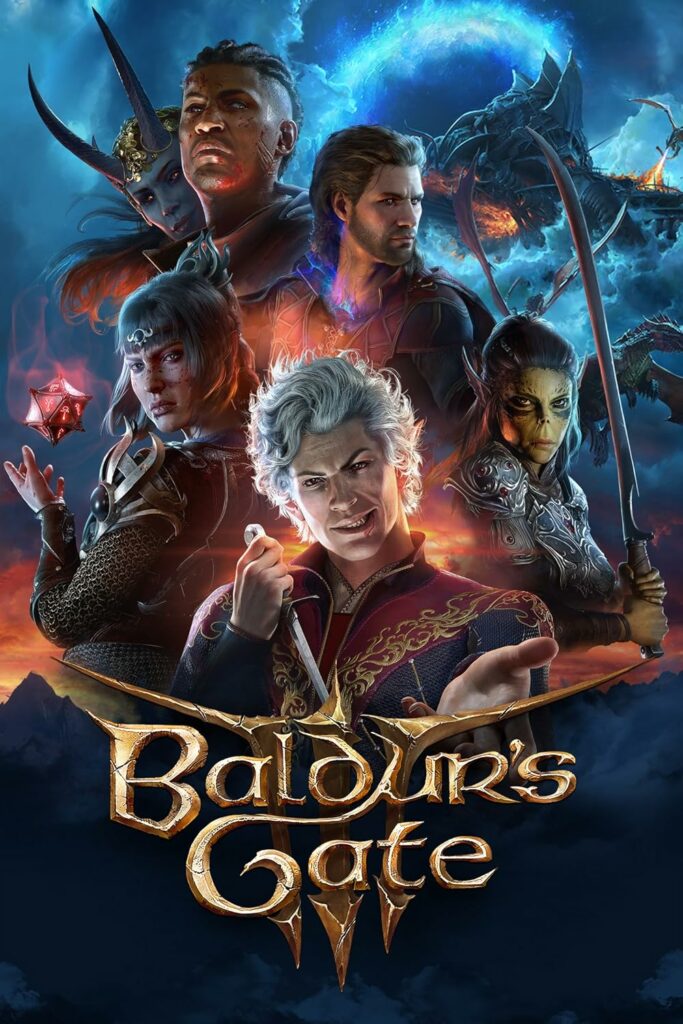
En revanche, j’ai détesté Gloomhaven: Les Mâchoires du lion. Détesté ça paraît fort mais vraiment ça faisait longtemps qu’un jeu ne m’avait autant mise en colère. Heureusement que c’était l’été sinon le jeu aurait pu finir dans la cheminée tant j’étais contrariée. Notamment, j’ai beaucoup de mal à éprouver du plaisir dans le gameplay qui repose sur du tour par tour.
Je me suis fait la remarque qu’il existe pas mal de similarités entre ces deux jeux, avec des éléments qui sur le papier ont tout pour me plaire :
- Ils se déroulent tous dans un univers fantasy, teinté plus ou moins de Donjons & Dragons (dans Baldur’s Gate on est littéralement dans l’univers de D&D) ;
- Ils promettent des combats mémorables, de l’exploration, des récompenses, de la montée de niveau, bref de l’Aventure.
Et j’en suis revenue à une de mes marottes, une de mes lubies ludiques : pourquoi suis-je globalement déçue par les jeux de société qui me promettent de vivre une aventure ? Je sais que c’est un sujet que j’aborde régulièrement et pourtant j’ai l’impression que je ne parviens qu’à l’effleurer à chaque fois que j’y réfléchis.
Je vais essayer de donner une nouvelle fois des éléments de réponse, probablement qui feront écho à des points que nous avons déjà abordés déjà ensemble dans la chronique sur l’esprit du jeu ou encore dans ta chronique sur les histoires racontées par le jeu.
1) Qu’est-ce qu’un jeu d’aventure ?
Le jeu d’aventure est un terme très générique, protéiforme qui rend d’autant plus difficile son analyse. Il ne repose pas sur une mécanique particulière, il peut emprunter à plusieurs genres (comme le dungeon crawler pour Gloomhaven), s’exprimer dans des univers différents (med-fan, pirates, science fiction, mythe de Cthulhu).
L’aventure serait donc plutôt un thème (selon le véritable sens qu’on devrait peut-être attribuer à ce terme dans le jeu de société) : il s’agit de faire vivre aux personnages, souvent par l’intermédiaire d’une exploration et de résolution de rencontres (combats, pièges, trésors) une quête qui permet de mettre en valeur l’héroïsme des personnages en leur donnant l’illusion d’avoir choisi leur chemin.
De cette acception, on peut tirer trois critères :
- L’exploration est primordiale, celle-ci peut se faire sur un terrain connu d’avance ou qui se révèle au fur et à mesure de l’avancée des joueuses ;
- L’existence d’une quête, qui exige des personnages qu’ils mènent à bien une mission spécifique. Elle peut être assez triviale (“buter tous les monstres”) comme complexe (un objectif assez vague qui ne prend son sens qu’au fur et à mesure de la partie, voire de la campagne) ;
- Les personnages doivent vivre des moments épiques et héroïques, permettant aux joueuses d’éprouver un sentiment d’accomplissement. Il ne s’agit pas que de combats mais aussi de choix cruciaux, de moments décisifs, qui leur permettent de forger le destin de leurs personnages.
Des jeux d’aventure, mes étagères en sont pleines. Même quand l’exploration et la quête sont bien présentes, le sentiment d’héroïsme ou d’épopée est souvent affaibli — comme si certaines mécaniques ou logiques de jeu étouffaient l’émotion qu’on voudrait ressentir
- Destinies, un jeu de Michał Gołąb Gołębiowski et Filip Miłuński, édité en français par Lucky Duck Games, qui exploite un univers médiéval plus réaliste que la fantasy, avec des scénarios plutôt bien écrits. Il se joue avec une application malheureusement trop présente et souffre de son côté Fedex ainsi que d’une immense place laissée à… la chance ;
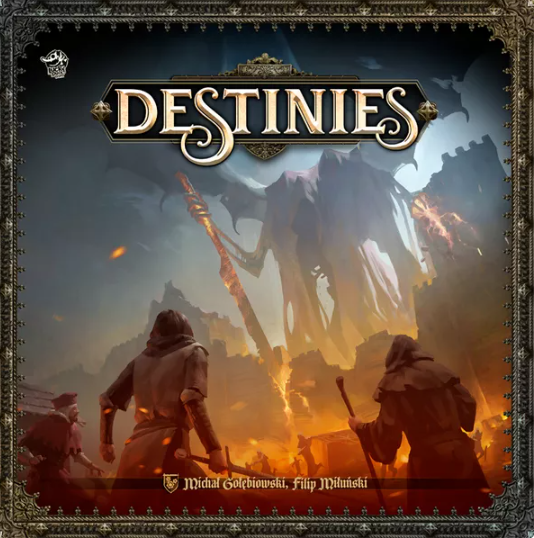
- Le Seigneur des Anneaux :Voyages en terre du milieu, de Nathan I. Hajek et Grace Holdinghaus, édité par FFG, qui lui aussi utilise une application (beaucoup moins invasive) et dont le système de résolution avec des decks de cartes plutôt réussi ;
- Time Stories, de Manuel Rozoy, édité par Space Cowboys, qui a initié l’exploration de cartes avec des scénarios très immersifs mais des lourdeurs dans sa réalisation (les runs, les combats) ;
- Andor de Michael Menzel, et son univers medfan générique sans grande personnalité. Au final, il se révèle surtout un jeu d’optimisation d’actions et de coordination où il s’agit avant tout de rationaliser les tâches de chacun, souvent au détriment du plaisir de la découverte et de l’exploration.
Et bien sûr, on peut y ajouter les dungeon crawlers. Le dungeon crawling, qu’on retrouve dans le jeu de société comme le jeu vidéo, est hérité du jeu de rôle et se caractérise par :
- L’exploration d’une succession de zones, aléatoires ou prédéterminées ;
- La complétion desdites zones (avec une idée que l’objectif est en réalité la survie) : monstres, pièges, énigmes, loot
- L’amélioration des possibilités d’action des personnages (via l’équipement ou la montée des compétences).
Même si Gloomhaven fait quelques entorses à une définition puriste du dungeon crawling, notamment parce que les zones sont connues dès la mise en place, il s’inscrit dans ce genre. Preuve en est la « pauvreté » de ses pitchs : on n’a pas besoin de scénario élaboré dans les dungeon crawlers puisque l’objectif c’est de vider le “donjon”. On s’en fout un peu des motivations des personnages, de leur créer tout un background social, psychologique, personnel. Un vague lore suffit. L’exploration elle-même et la survie suffisent.
Mais une fois ces éléments posés — exploration, quête, moments héroïques — je me rends compte que ça ne suffit pas. Ce n’est pas parce qu’un jeu coche toutes ces cases qu’il me donne l’impression de vivre une aventure. Et c’est là que le bât blesse : pourquoi est-ce que certains jeux, pourtant bien pensés, bien écrits, bourrés de promesses, me laissent de marbre ? Pourquoi est-ce que, face à eux, je ne ressens ni frisson, ni attachement, ni cette petite vibration intérieure qui me fait dire : “là, il se passe un truc” ? Peut-être parce qu’au fond, ce n’est pas ce que le jeu propose qui compte, mais comment il me laisse le vivre. Et c’est là qu’on arrive à deux notions essentielles, que j’aimerais creuser maintenant : l’agentivité, et la narration émergente.
2) Agentivité et narration émergente
Tu l’as compris, de tous les jeux que j’ai cités, aucun ne m’a réellement convaincu.
Certes dans les jeux d’aventure, l’univers proposé et la qualité de l’écriture sont importants, essentiels mais pas suffisants pour ressentir l’héroïsme. Il faut quelque chose en plus que le jeu de société a du mal à offrir à ce jour : un sentiment d’immersion réel dans lequel nos choix ont une incidence réelle sur le cours de l’aventure. Les joueuses doivent donc éprouver un sentiment de liberté.
a) La narration émergente
Le jeu d’aventure fait appel à l’imaginaire des joueuses : il faut qu’elle se projette et s’approprie ce que leurs personnages sont en train de vivre.
Or cette appropriation ne peut pas se contenter de passer ni par le lore, ni par le fluff, ni par les textes d’ambiance. Selon moi, il passe par la capacité des auteurices à créer une narration émergente, c’est-à-dire une narration créée par les joueuses et non imposées par le jeu. Et c’est quand les joueuses s’approprient le jeu pour y raconter l’histoire qu’elles ont choisies que le sentiment d’aventure naît vraiment.
La narration émergente suppose que le jeu est un système vivant, façonné autant par les joueuses que par les auteurices. Pour que cela marche, il faut laisser cette place aux joueuses et parfois renoncer à trop de narration imposée.
On retrouve cette idée notamment dans le travail de Rob Daviau, notamment avec son exploration des jeux legacy. Dans ces jeux, la narration n’est pas (ou pas seulement) un texte imprimé. Elle émerge des mécanismes (destruction d’une carte, écriture d’un nom sur le plateau, révélation d’une boîte scellée). Le jeu n’est donc plus un objet mais le réceptacle d’une expérience unique pour un groupe unique.
Sans aller jusqu’à l’extrême des jeux legacy, je ne peux pas résister au fait de parler une nouvelle fois de Cthulhu : Death May Die qui réussit parfaitement sa mission de jeu d’aventure en évitant les écueils de la maintenance scriptée.
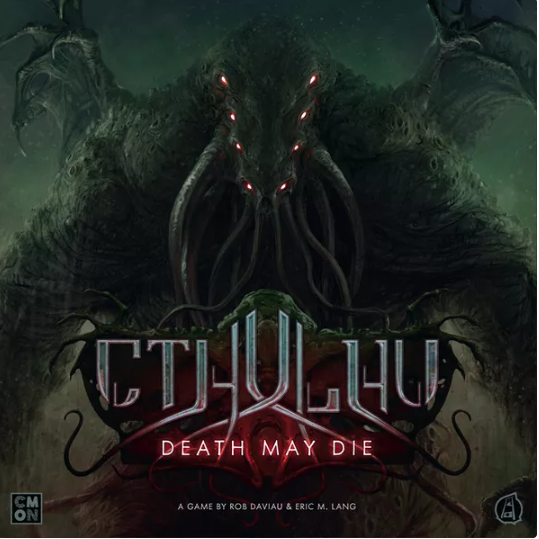
Cthulhu : Death May Die est lui-aussi un dungeon crawler, ou plutôt un mission crawler. Chaque scénario propose une mission à mener à bien afin d’interrompre un rituel et ensuite pouvoir vaincre le grand ancien. Si la mission change à chaque scénario, la finalité est toujours la même : buter le grand ancien. Le fluff du jeu reste léger, souvent drôle. La mécanique du jeu est très épurée, simplifiant tout ce qui pourrait créer de la confusion dans l’application des règles.
Les joueuses peuvent donc se concentrer pleinement sur leurs actions, leur partie, leur groupe et comment elles vont s’en sortir. La tension dramatique est maintenue parfaitement grâce à cette idée que la perte de la santé mentale rend plus fort mais conduit aussi probablement à la mort. Même mourir dans ce jeu n’est pas un problème : on choisira toujours une mort héroïque qui permet une victoire plutôt qu’une défaite en vie.
b) L’agentivité
Donner aux joueuses l’impression qu’elles sont maîtresses du destin de leurs personnages passe également par le fait de leur rendre leur agentivité.
Dans les jeux d’aventure qui sont en réalité très scénarisés, c’est plutôt une illusion d’agentivité qui va être donnée : donner l’impression aux joueuses qu’elles font des choix, pas seulement stratégiques, mais des choix qui affectent leur destin.
On comprend que dans le jeu vidéo, la tâche est plus aisée. En jouant à Baldur’s Gate 3, je sais que les différents choix que je ferai affecteront le monde dans lequel j’évolue, mes relations avec les autres PNJ, que certains arcs narratifs se refermeront à jamais pour cette partie. On est donc obligé d’y réfléchir à deux fois lorsque l’on s’apprête à attaquer un groupe de PNJ non hostile ou lorsqu’on a une simple discussion légère avec un membre de notre groupe au campement. Si cela tourne mal, on ne peut s’en prendre qu’à soi-même. Lorsqu’on parvient à nos fins, on se sent seule responsable de son succès. C’est donc un subtile équilibre entre éléments pré-scénarisés et libre arbitre partiel laissée à la joueuse.
Dans les jeux de société, un tel degré de subtilité est plus difficile à atteindre en raison même du média jeu de société parce que au final c’est bien l’humain que nous sommes qui devra gérer ces embranchements de décisions et non un outil informatique, avec toutes les limites que cela comporte.
Toutefois, j’ai récemment commencé la campagne d’un jeu dont on m’avait dit le plus grand mal dans lequel j’ai eu un peu ce sentiment de faire des choix impactant.
Tainted Grail est un jeu de Krzysztof Piskorski et Marcin Świerko, édité par Awaken Realms,. Le jeu souffre de certaines lourdeurs mécaniques (que j’ai aussitôt décidé d’alléger en reprenant les aménagements de la v2) et d’un certain côté LDVELH (on passe quand même beaucoup de temps à lire ce qu’il se passe dans le livret de campagne). Pourtant, Tainted Grail m’a agréablement surprise par un réel effort d’écriture, mais surtout par le sentiment de grande liberté qui était laissée dans la façon de résoudre les scénarios proposés. Certains choix réalisés semblent changer le déroulé de l’aventure, ce qui implique d’y réfléchir à deux fois avant de les formuler.
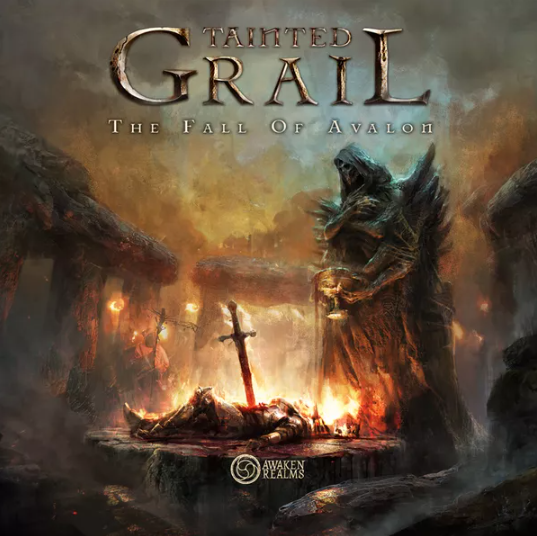
Conclusion : et Gloomhaven dans tout ça ?
A l’issue de toutes ses réflexions, je sais un peu mieux ce que je recherche dans un jeu d’aventure.
Et je sais parfaitement pourquoi Gloomhaven ne m’a pas plu. Malgré sa très bonne cotation BGG (le Gloomhaven originel a longtemps été numéro 1) et les excellents retours que j’ai eu sur ce jeu (dont toi Christian, oui, oui, qui m’a dit que tu avais fait toute la campagne et apprécié le jeu), ce jeu ne peut pas marcher avec moi.
Gloomhaven n’est juste pas un jeu d’aventure. Ou en tout cas, il ne cherche pas à te faire ressentir l’immersion, l’héroïque ou l’épique. Il en a l’univers, les visuels, le lore, l’imaginaire, les codes mais ce n’est que de la cosmétique. Il est un tout autre type de jeu maquillé en jeu d’aventure.
En général, ce qui revient le plus souvent quand on parle de Gloomhaven c’est son système de cartes qui détermine les actions des personnages et l’initiative.
Pour simplifier, à son tour de jeu on choisit deux cartes : une dont on fera l’effet haut de la carte et une dont on fera l’effet bas. On choisit également et on annonce la valeur d’initiative de nos actions pour ce tour : plus le numéro est bas, plus on joue en premier. Mais attention, les ennemis tirent leur carte d’initiative APRES notre choix. On fait donc un pari tactique et un peu de prise de risque.
Je ne peux pas nier que ce système de cartes est ingénieux. Il y a une vraie beauté dans cette mécanique à deux vitesses, cette tension constante entre conserver ses actions et les utiliser à pleine puissance. C’est bien pensé, c’est élégant même et ça renouvelle bien le genre.
Mais ce système, aussi bien conçu soit-il, reste au service d’un jeu d’optimisation. Un jeu froid, rigoureux, où chaque choix doit être parfaitement calibré, où l’échec punit sans appel, et où la moindre erreur se paie cash. C’est un jeu où l’on passe plus de temps à lire et décoder ses cartes qu’à vivre quoi que ce soit.
Un jeu qui t’invite à incarner un artificier ou une gardienne du néant, mais qui te demande surtout d’être un bon planificateur. Tu vas peut-être rire, mais moi jouer à Gloomhaven ça m’a fait penser à mon travail.
Et parce que cet aspect du jeu l’emporte tellement sur tout le reste (le niveau d’écriture de l’intrigue est vraiment aux fraises, les missions sont extrêmement répétitives), il ne peut pas me plaire. Je m’attendais à de l’aventure épique, j’ai trouvé un jeu très tactique, où la moindre erreur se paie cash.
Il te demande juste de bien jouer. Or, je ne veux pas que les tours de jeu me permettent juste de vérifier que j’ai bien joué. Je veux ressentir quelque chose. Ce décalage entre les promesses et la réalité du jeu crée une profonde désillusion ludique par rapport à mes attentes. Car moi dans un jeu d’aventure, ce que je veux c’est me sentir une héroïne, pas prouver que je sais bien optimiser.