
Ce texte est la transcription de la chronique proposée en podcast dans le format Pelleter des nuages (audio dispo ici).
Est-ce que vous trichez aux jeux de société ? Enfin, il y a tricher et tricher. Bien sûr, je ne vous demande pas si ça vous est déjà arrivé de sciemment ne pas dépenser tes ressources pour construire un bâtiment pendant que tes adversaires ne faisaient pas attention. Evidemment, ça c’est mal.
Non je parle de ces arrangements que l’on fait parfois avec le jeu, surtout dans les jeux coop : un lancer de dés catastrophique aux Contrées de l’horreur où on dit que bon on a le droit à une relance gratuite par partie, les runs qu’on ne compte plus à Time Stories parce que ce qui compte c’est l’histoire, cette piste qu’on compte pas dans Sherlock Holmes Detective Conseil parce qu’en fait on ne voulait pas vraiment aller à cet endroit-là et que ce qui compte c’est l’enquête pas le score. Et bien moi, ça m’arrive bien souvent. Et en général, dans ces moments-là j’invoque sur le ton de la plaisanterie, l’esprit du jeu, le fameux.
Mais une fois que j’ai affirmé, de façon un peu péremptoire je te l’accorde, que ce n’est pas vraiment tricher parce que c’est fait dans l’esprit du jeu, vous allez naturellement me demander : « Mais Polgara c’est quoi pour toi l’esprit du jeu ? Et jusqu’où on peut aller au nom de l’esprit du jeu ?« .
Et bien en réalité, quand on parle de l’esprit du jeu on l’oppose implicitement à la lettre du jeu, c’est à dire la règle, ou plutôt les règles du jeu. Et bien sûr, cette expression de « esprit du jeu » résonne très fortement comme l’esprit de la loi. Et peut-être que je vais faire hurler tous les joueurs de jeux de société mais oui moi je pense que l’esprit du jeu est bien plus important que ses règles, alors que pourtant on sait (c’est toi même qui nous l’as dit d’ailleurs dans une de tes précédentes chroniques) que l’existence d’une règle est un élément caractéristique du jeu.
La règle est la loi entre les joueuses
Pour paraphraser l’expression consacrée “le contrat a force de loi entre les parties”, on peut probablement dire que les règles ont force de loi entre les joueuses. S’asseoir à une table de jeu c’est un contrat auquel on adhère avec les autres joueuses et on accepte temporairement de se laisser gouverner par les règles qu’un auteur a conçues pour organiser les différentes interactions le temps de la partie.
Les règles constituent un système complet et figé, qui se suffit à lui-même ; il n’a pas vocation à évoluer, ou de façon marginale : certains points de règles pourront être précisés (par exemple dans des FAQ) ou modifiés en fonction des éventuelles rééditions. Mais ces évolutions restent minimes, sauf à considérer qu’elles aboutissent à la création d’un autre jeu.
En revanche, la loi évolue sans cesse. D’abord parce qu’une loi peut être abrogée, remplacée, réformée. Elle s’adapte constamment aux évolutions de la société et à ses besoins. Et aussi parce que la loi est toujours imparfaite et ne se suffit jamais. Pour être applicable, elle nécessite souvent des décrets, parfois la publication de doctrine, par des universitaires, des praticiens ou encore l’administration elle-même. Mais surtout, elle est interprétée, notamment par la jurisprudence, donnant lieu parfois à des revirements, c’est-à-dire des décisions qui changent radicalement la façon d’appliquer un texte.
Or, on peut aussi constater que les règles des jeux sont également imparfaites, peu claires, mal traduites, n’explicitent pas nécessairement tous les cas particuliers, ou en tout cas pas suffisamment bien. Comme parfois on recherche l’intention du législateur, par exemple au travers des débats parlementaires, pour interpréter et appliquer au mieux la loi, on peut rechercher l’intention de l’auteur pour déterminer comment appliquer au mieux la règle du jeu. Cette intention peut se déduire notamment de l’équilibre global du jeu, du système qu’il porte.
Les règles incluent également implicitement des éléments parfois non écrits qui relèvent des conventions implicites, des conventions sociales, entre les joueuses (comme le fairplay, ne pas recourir au king making, jouer son coup dans un délai raisonnable). Les règles ne sont donc pas si figées que ça, et ce parce que le jeu lui ne l’est pas : il est joué, interprété, ajusté à chaque nouvelle partie.
La désacralisation de la règle
Les règles du jeu sont avant tout une norme technique, la traduction mécanique d’une intention de l’auteur du jeu. Elles ne sont pas une finalité, elles n’existent pas pour elles-mêmes, elles n’ont pas de finalité propre si ce n’est qu’être au service d’un dessein plus large. Tout comme la loi n’est qu’un outil, que la traduction juridique d’une volonté politique.
Dans cette approche, la règle est fonctionnelle mais elle traduit toujours une intention, elle reflète une certaine manière de concevoir les interactions, la compétition, le hasard, la victoire, etc. C’est donc un outil mais au service d’une idéologie.
Les règles du jeu sont donc un cadre, qui oriente et suggère des comportements. Elles ne sont donc pas neutres. Et cette absence de neutralité implique donc qu’il soit légitime de les questionner.
En effet, appliquer la règle rigoureusement, sans prendre du recul, sans tenir compte du contexte, peut conduire à des effets contraires à l’intention initiale de l’auteur : des blocages, des déséquilibres, voire des injustices et surtout du déplaisir à jouer.
Par conséquent, le respect de la règle n’a de valeur que s’il sert le respect du jeu compris comme le fait de jouer ensemble et non comme l’objet jeu.
Or, comme je l’ai dit précédemment les règles peuvent être imparfaites, mal écrites, mal traduites, interprétables, incomplètes, incompréhensibles. Par conséquent, elles ne peuvent être considérées comme sacrées par essence. Les joueuses ont dès lors le droit, peut-être même le devoir de se les approprier pour que le jeu fonctionne, pas mécaniquement bien sûr (car bien souvent le jeu tourne comme on dit) mais en terme d’expérience satisfaisante.
Une fois publiée, l’œuvre échappe à son créateur. Elle appartient aux joueuses.Les joueuses se l’approprient. Tout comme en littérature, en théâtre, ou comme pour toute œuvre d’art, si l’on veut paraphraser Roland Barthes : La naissance de la joueuse doit se payer de la mort de l’auteur.
Si la règle n’est pas sacrée, alors on peut choisir de s’en détourner, d’inventer des variantes. Je me souviens à cet égard d’une anecdote qui serait amusante si elle n’était pas empreinte d’une certaine violence : une personne disait énormément apprécier un jeu, au point qu’il en avait inventé une variante qui, selon elle, corrigeait certains défauts de la règle originelle. Et bien je te garantis que cette personne s’était fait copieusement rabrouer par l’auteur du jeu qui lui avait expliqué que son propos était totalement irrespectueux, à l’égard du jeu comme de l’auteur. La règle était manifestement tant sacrée qu’elle ne pouvait souffrir d’être modifiée.
C’est aussi en reconnaissant cette place prépondérante aux joueuses, en reconnaissant qu’un jeu, une fois publié, échappe à ses créateurs, qu’on fera progresser l’idée d’une critique du jeu de société à l’image de la critique qui existe dans les autres disciplines artistiques. Si on accepte que la règle n’est pas sacrée parce qu’elle est n’est pas que technique mais qu’elle porte une vision du monde, une intention, alors on peut l’interroger, la débattre, la contester. Et cela participe certainement à une pratique ludique émancipée, consciente et engagée.
La place des joueuses
Le jeu n’existe que abstraitement tant qu’il n’est pas joué. Certes, son système préexiste mais il n’est pas encore une partie. Ce n’est qu’à partir du moment où un groupe de joueuses (un bon groupe de joueuses oserais-je dire) pour appliquer ces règles dans un contexte réel, avec des personnes réelles, que le jeu prend vie. Les règles structurent la partie mais celle-ci est une activation, un cas d’application. Le jeu ne suffit pas pour jouer.
Ce sont bien les joueuses qui opèrent cette activation : elles apprennent les règles, les appliquent, les interprètent et résolvent les cas imprévus s’il en survient. Elles sont donc le temps de la partie les juges investis du pouvoir de rendre les règles effectives, de les adapter à la partie en cours. Et pour ce faire, elles peuvent évidemment s’appuyer sur toutes les ressources mises à leur disposition, y compris l’esprit du jeu. L’esprit du jeu c’est donc l’intention qui sous-tend la règle, la dynamique que le système cherche à produire, l’expérience que veut procurer le jeu.
Ainsi, les joueuses exercent ainsi une souveraineté d’usage : elles adaptent, interprètent, choisissent ce qui fera sens pour une partie donnée. Parce qu’elles ont collectivement adhéré au jeu en décidant de se retrouver autour de la table et de l’activer.
Et c’est là toute la différence avec la loi : dans une démocratie parlementaire, on élit des représentants qui eux votent les lois. A partir de ce moment-là, les citoyennes ont en réalité très peu de contrôle sur le contenu des lois votées. Dans le cadre ludique, les joueuses subissent les règles et en même temps sont garantes de leur application, afin de permettre de vivre une expérience collective plus satisfaisante.
Conclusion
Laisser le pouvoir ultime de décision aux joueuses, faire passer leur volonté avant la lettre, le texte au sens strict, des règles peut être parfois perçu comme une sorte de trahison, à l’égard du jeu et même de son auteur. Pourtant, la joueuse peut être pleinement considérée comme co-autrice du jeu, parce que sans elle la partie ne se joue pas. Certains diront co-créatrices de l’expérience de jeu.
Je ne dis pas que l’on doit ignorer les règles. Simplement qu’elles ne sont pas intouchables car elles ne sont pas tout le jeu. Et oui parfois désobéir c’est peut-être mieux jouer. Cette désobéissance ne s’opère pas pour tricher mais pour préserver l’esprit du jeu, c’est-à-dire préserver l’expérience proposée par le jeu que la règle appliquée trop strictement viendrait mettre en péril.

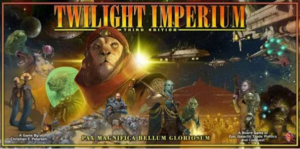


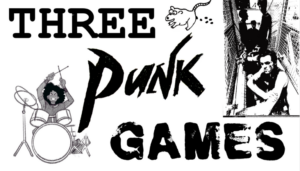


Bonjour,
Tout à fait en phase avec cette chronique et cet esprit du jeu, dont je fais part quand j’explique des règles particulièrement en festival (notamment ce WE à l’Alchimie du Jeu), en partageant mon expérience.
Par exemple, dans La Famiglia, il y a un encart sur le travail d’équipe. Je vais au delà de ce qui est indiqué dans la règle, en indiquant que des limites sur la communication sont bienvenues (ce sont quand même des famille mafieuses), plus restrictives que celles de la règle. De la même façon, j’invite les joueurs et les joueuses à ne pas utiliser les cartes de bluff.
Autre exemple, dans Cerbère, j’explique que le but du jeu est bien de sortir vivant et que faire exprès de rejoindre Cerbère permet certes d’être associé à la victoire du chien des Enfers, mais ne constitue pas « La Victoire ».
Je ne procède pas de la même façon hors festival car les joueurs et joueuses ont a mon sens plus d’opportunités d’écrire leur règle.
Merci pour ce podcast si riche
Hello
Merci beaucoup pour ton écoute et tes commentaires.