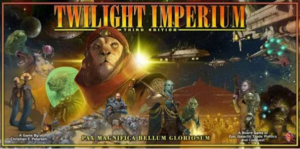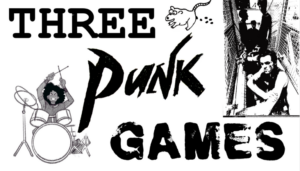Ce texte est la transcription de la chronique proposée en podcast dans le format Pelleter des nuages (audio dispo ici).
Quand j’ai lu Carboard Ghosts de Amabel Holland (a-t-on déjà parlé de Amabel Holland dans ce podcast ? oui c’est une question purement rhétorique), l’autrice fait notamment référence à un jeu de Erin Lee Escobedo, une autrice qui a beaucoup inspiré Amabel Holland elle-même, y compris sur le plan personnel. Ce jeu s’appelle Meltwater.
J’avoue qu’à ce moment de ma lecture, je n’avais jamais entendu parler de ce jeu. Je suis donc allée faire un truc complètement fou : j’ai mené quelques recherches complémentaires. Oui oui j’ai fait ce truc un peu dingue d’aller me renseigner sur cette personne, son jeu, les propos qu’on pouvait trouver d’elle sur le net. (Petite parenthèse pour vous donner un tips : renseignez-vous sur les gens, les oeuvres, les événements, etc… ça permet d’apprendre des choses intéressantes et ça permet de mieux appréhender les choses, plutôt que de se contenter du peu d’informations qui trainent à la surface).
Meltwater, dont le sous-titre A game of tactical starvation annonce la couleur (littéralement eau de fonte des glaces, un jeu de famine tactique), est sorti initialement en 2018 et a été publié par Hollandspiele (la maison d’édition de Amabel Holland). C’est, à ce jour, le seul jeu répertorié sur BGG de Erin Escobedo.
A la lecture de Cardboard Ghosts, j’étais vraiment curieuse de savoir de quoi il en retournait avec ce jeu. Parce que dans son ouvrage, Amabel Holland insistait sur le fait que le propos de ce jeu est de nous faire ressentir l’horreur de ce que nous faisons pour l’emporter : pousser la population de notre adversaire à la famine, comme le sous-titre du jeu le laisse entendre
Je fus donc ravie d’apprendre que le jeu bénéficiait d’une seconde édition proposée en 2025 par Capstone Games, dotée pour l’occasion d’une couverture à la fois magnifique et saisissante, qui sans en dévoiler les secrets donne déjà le ton de ce qu’on va y faire. Doutant de la probabilité d’une localisation française, je n’ai donc pas hésité une seconde à me le procurer durant la Gen Con. Et ainsi de pouvoir y jouer.
C’est ce que je vais essayer de partager aujourd’hui : je vais essayer de vous restituer ce que j’ai “compris” du jeu et du propos de son autrice dans Meltwater. Mais aussi, de la façon dont Erin Escobedo conçoit le jeu à deux, comme elle l’explique dans une vidéo passionnante réalisée par Amabel Holland et diffusée sur sa chaîne YouTube (Player Counts: Scaling in board games, qu’on peut traduire par Nombre de joueurs : comment les jeux s’adaptent).
Préambule : en quoi consiste Meltwater ?
Meltwater est un jeu d’affrontement pour deux joueuses aux allures de wargame puisqu’il propose d’incarner les Etats-Unis ou la Russie, luttant pour survivre sur le territoire hostile de l’Antarctique. Outre la famine, chaque faction doit faire face à l’avancée des radiations déclenchées par la guerre nucléaire que ces deux nations ont elles-mêmes provoquée. Enfin, des populations réfugiées neutres rejoignent également l’Antarctique augmentant alors le nombre de bouches à nourrir.

Pour l’emporter, il faut anéantir la faction adverse et être seule encore présente sur le territoire.
Un tour de jeu à Meltwater se décompose en une phase préliminaire où on tire les conséquences du tour précédent, une phase d’actions et une phase de résolution de la propagation selon la carte en cours.
Tout d’abord, on résout les conséquences de la phase précédente : les réserves présentes dans une case irradiée sont détruites, puis on résout la famine et on constate les pertes éventuelles de civils.
Ensuite, la joueuse joue ses 4 actions parmi : se déplacer, menacer (permet de forcer un civil à se déplacer), faire pression (recruter les réfugiés neutres dans sa faction), attaquer (tuer un soldat adverse) et militariser (transformer un civil en militaire).
Enfin, on résout la carte événement qui indique où se propagent les radiations et où débarquent les réfugiés.
Je reste volontairement lacunaire dans cette explication car les points les plus notables des règles sont ceux qui vont évidemment faire l’objet de la première partie de cette chronique.
1) Ce que les joueuses ne maîtrisent pas : les radiations
A chaque tour de jeu, la radiation s’étend sur le territoire occupé par les joueuses. Cette progression répond à un schéma représenté sur des cartes événements révélées à chaque tour.
Impossible de ne pas penser à Pandémie :
– propagation des radiations à la manière des épidémies,
– quand deux jetons radiation sont présents sur la même case, le territoire devient inaccessible aux survivants (et entraîne la mort de ceux qui s’y trouvent) comme les villes de Pandémie deviennent peu à peu inaccessibles à mesure de leur détérioration,
– localisation des radiations en fonction de cartes événements,
On pourrait alors imaginer que le jeu inclut une forme de coopération entre les joueuses, dans le cadre de laquelle elles pourraient être amenées à faire front commun contre le système du jeu.
Pourtant, la comparaison s’arrête là. Contrairement à Pandémie dans lequel les joueuses peuvent endiguer par leurs actions l’avancée des maladies, aucune des actions offerte aux joueuses ne leur permet de ralentir ou stopper la progression des radiations. Aucune. Une mort certaine attend leurs survivants. D’ailleurs, si le jeu s’éternise, tout le monde meurt à la fin. La coopération est rendue impossible par le design du jeu si on y joue (elle ne marche selon les explications de l’autrice que si on s’organise de suite sur le plateau pour se répartir les stocks de provisions et qu’on arrête la partie quasi immédiatement, avant que les radiations ne progressent).

Cette mort inexorable qui avance petit à petit est ce qui fait monter progressivement la tension entre les joueuses. Si chacune commence de son côté du plateau avec ce sentiment que finalement l’Antarctique est bien vaste et qu’on devrait pouvoir s’en sortir sans trop de difficulté, il y a dans le jeu ce point de bascule où on prend conscience (et pourtant on le savait) que le territoire sur lequel nos civils peuvent se tenir se réduit lentement mais sûrement. Un peu comme dans Players Unknown Battle Ground.
Initialement, Erin Escobedo avait pensé à la pression démographique plutôt qu’aux radiations. C’est en pensant aux radiations que le thème du jeu lui est venu.
Si l’on joue à Meltwater comme on joue à n’importe quel jeu, on sera heureux d’être la dernière debout. Si on prend un peu de recul, alors on réalise que la victoire n’est qu’un sursis.
A cet égard, le jeu propose même de capituler si on a conscience que c’est foutu, qu’on ne peut pas gagner, cette décision étant motivée par l’idée d’épargner nos derniers survivants qui finiront par rejoindre la faction adverse pour ne pas être condamnés à mourir de faim. En proposant ceci, l’autrice prend le contrepied de la stratégie du Général Thomas Power. Pour résumer, celui-ci avait une vision très agressive des conflits et, outre le fait que les vies des populations ennemies n’avaient aucune importance pour lui, les vies de sa propre population n’en avait pas plus si les sacrifier permettait de gagner la guerre.
Meltwater parle aussi du sort des civils dans les conflits, ceux qu’on ne voit que rarement dans les wargames. Meltwater nous dit qu’à un moment on peut arrêter cette absurdité parce que de toute façon nous sommes tous voués à la mort. Autant épargner le plus possible les populations civiles.
2) Ce que les joueuses maîtrisent : “l’affrontement”
Meltwater n’est pas un wargame. Il lui emprunte clairement certains codes. Mais il les tord pour faire vivre aux joueuses une toute autre expérience
Le thème du jeu (un monde post guerre nucléaire entre Soviétiques et Etats-Unis) renvoie immédiatement à tout un imaginaire associé à tort ou à raison au wargame ou encore à Twilight Struggle. D’ailleurs, le livret de règles s’ouvre sur une citation de Power qui figure également dans le livret de Twilight Struggle.
« La retenue ? Pourquoi êtes-vous si préoccupés par le fait de sauver leurs vies ? Toute l’idée est de tuer ces salauds. À la fin de la guerre, s’il reste deux Américains et un Russe en vie, nous avons gagné. »
Mais Meltwater, contrairement à Twilight Struggle, ne se réclame pas d’une véracité historique. Il se situe dans un futur dystopique dans lequel la catastrophe nucléaire tant redoutée est survenue. Il n’est pas card-driven avec tout un tas de cartes sur lesquelles de pseudo événements historiques surviendraient.
Son asymétrie est trompeuse. Certes, sur le papier chaque joueuse incarne une nation, Etats-Unis ou URSS. Mais hormis le placement de départ des unités qui est fixe et dépend de la faction choisie, aucune différence n’existe entre les deux.
Les actions possibles sont strictement identiques. Aucun pouvoir spécial n’est attribué à l’un plutôt qu’à l’autre. La condition de victoire est similaire. Exactement, comme dans This Guilty Land nous faisions la remarque que les effets des cartes étaient les mêmes, que l’on joue la Justice ou l’Oppression. Et bien, qu’on soit les Etats-Unis ou la Russie, on joue exactement pareil. Nous sommes exactement les mêmes : des humains qui tentent de survivre dans un monde hostile. ce que l’on fait subir à l’autre c’est ce que nous subissons nous-mêmes. Un moyen aussi d’entrevoir l’absurdité de la guerre.
Dans Meltwater, la guerre est absurde et elle n’est pas noble. Les wargame nous parlent souvent de batailles héroïques, de combats épiques, de choix militaires stratégiques. Ici, il est question des civils qui tentent de survivre au milieu d’un affrontement vide de sens.
Il ne s’agit pas d’un jeu d’affrontement dans lequel on conquiert des territoires. C’est même tout le contraire : on lutte pour survivre, et être le dernier à survivre, sur un territoire qui se rétrécit petit à petit pendant que les ressources alimentaires s’amenuisent.
D’ailleurs, dans Meltwater, on ne se tue pas, ou rarement, on se condamne à la famine et à une mort inéluctable, et ça change tout le ressenti émotionnel de ce que l’on fait. Ce n’est pas un élan spontané mais une décision de gestion, d’optimisation… et c’est ce décalage qui rend l’expérience si dérangeante.

Contrairement à de nombreux jeux d’affrontement, Meltwater n’est pas un jeu cathartique. Il ne nous permet pas de l’éprouver. Ce n’est pas son propos et c’est sans doute très bien comme ça.
3) Le face à face
Les jeux à deux, lorsqu’ils sont compétitifs, sont souvent conçus comme des jeux d’affrontement. Le jeu à deux est l’espace le plus brut, le plus intime pour explorer la compétition et l’opposition. Bien sûr, Meltwater reste un face à face. Mais plus qu’un affrontement direct et frontal, c’est un huis-clos étouffant dans lequel on se regarde dans les yeux pendant qu’on condamne les unités de l’autre à la famine.
Erin Escobedo explique dans la vidéo d’Amabel Holland précitée que pour elle la configuration à deux joueuses fait du jeu un espace de conversation : l’une avance un argument, l’autre y répond, et ainsi de suite. Meltwater est pensé comme un dialogue tendu entre deux personnes. L’intimité du jeu à deux devient alors une intimité cruelle, entre deux survivants qui savent déjà que tout est perdu.
Il y a quelques mois, j’avais parlé de The Mind dans sa configuration à deux comme d’un jeu capable de faire ressentir des émotions proches de celles de la fusion qu’on peut éprouver dans la relation amoureuse, de cette symbiose, de ces deux rythmes personnels qui cherchent à ne faire qu’un.
Et bien Meltwater c’est un peu l’illustration de la désunion glaciale, de ce duel froid et distant dans lequel on partage certes un espace mais pour mieux s’y repousser, s’y étouffer. Meltwater c’est un peu une séparation, un divorce, qui se déroulerait lorsque la relation amoureuse a fait place à une hostilité froide et sans aucun reste du sentiment amoureux.
Comme dans une séparation, le jeu impose une proximité forcée le temps que l’on règle les détails matériels. L’indifférence envers l’autre est sans éclats : pas de hurlement, juste des petites décisions égoïstes qui condamnent l’autre. Et le jeu induit un très fort fatalisme : à la fin, il n’y aura pas de réconciliation, seulement la certitude qu’un des deux s’effondrera avant l’autre.
Conclusion
Après y avoir joué, avoir lu le carnet d’autrice de Erin Escobedo et avoir fait quelques recherches complémentaires sur le jeu, je comprends mieux ce que Amabel Holland en disait.
J’ai gagné à Meltwater et pourtant je te garantis que je n’en ai tiré aucune fierté, aucun plaisir. J’étais même plutôt mal à l’aise et j’avais tout sauf envie de fanfaronner (oui parce que je fanfaronne habituellement quand je gagne).
J’ai perdu à Meltwater. Ou plutôt j’ai capitulé. J’ai choisi de faire ce que propose Erin Escobedo à la fin des règles du jeu et qui manifestement n’aurait pas été du goût du Général Power : j’ai concédé la défaite quand je pouvais encore le faire “avec dignité” parce que poursuivre le combat pour la survie était devenu encore plus absurde que l’absurde. C’était un peu bizarre. Mais étonnamment je m’en suis sentie soulagée.
Meltwater ne cherche pas à nous divertir mais à nous rappeler que certaines victoires sont illusoires : elles ne sont que des sursis. Parfois jouer, c’est aussi regarder l’absurde en face, celui de vouloir traverser l’inconfort d’un monde où la survie de l’un ne peut exister qu’au prix de la disparition de l’autre.